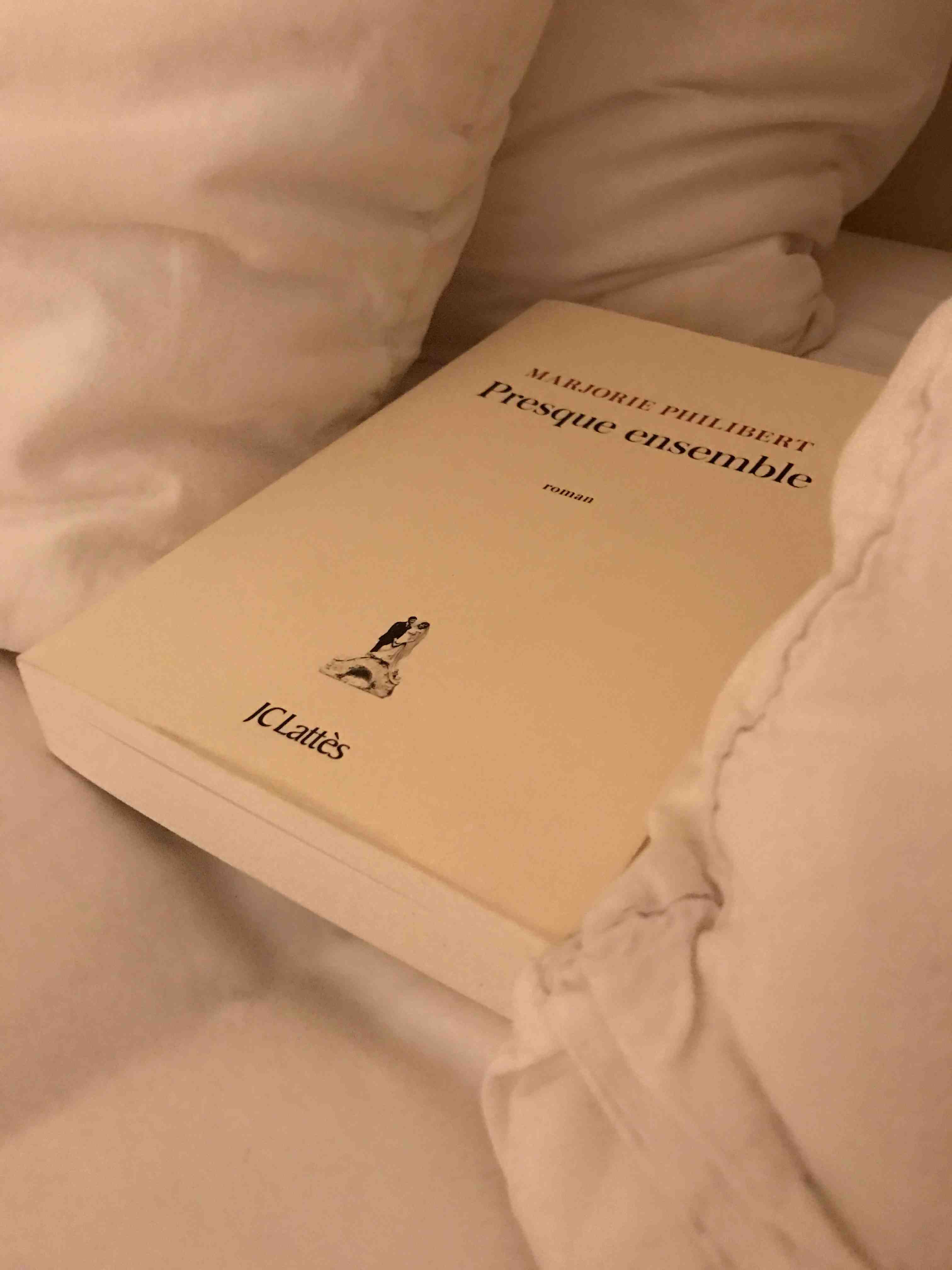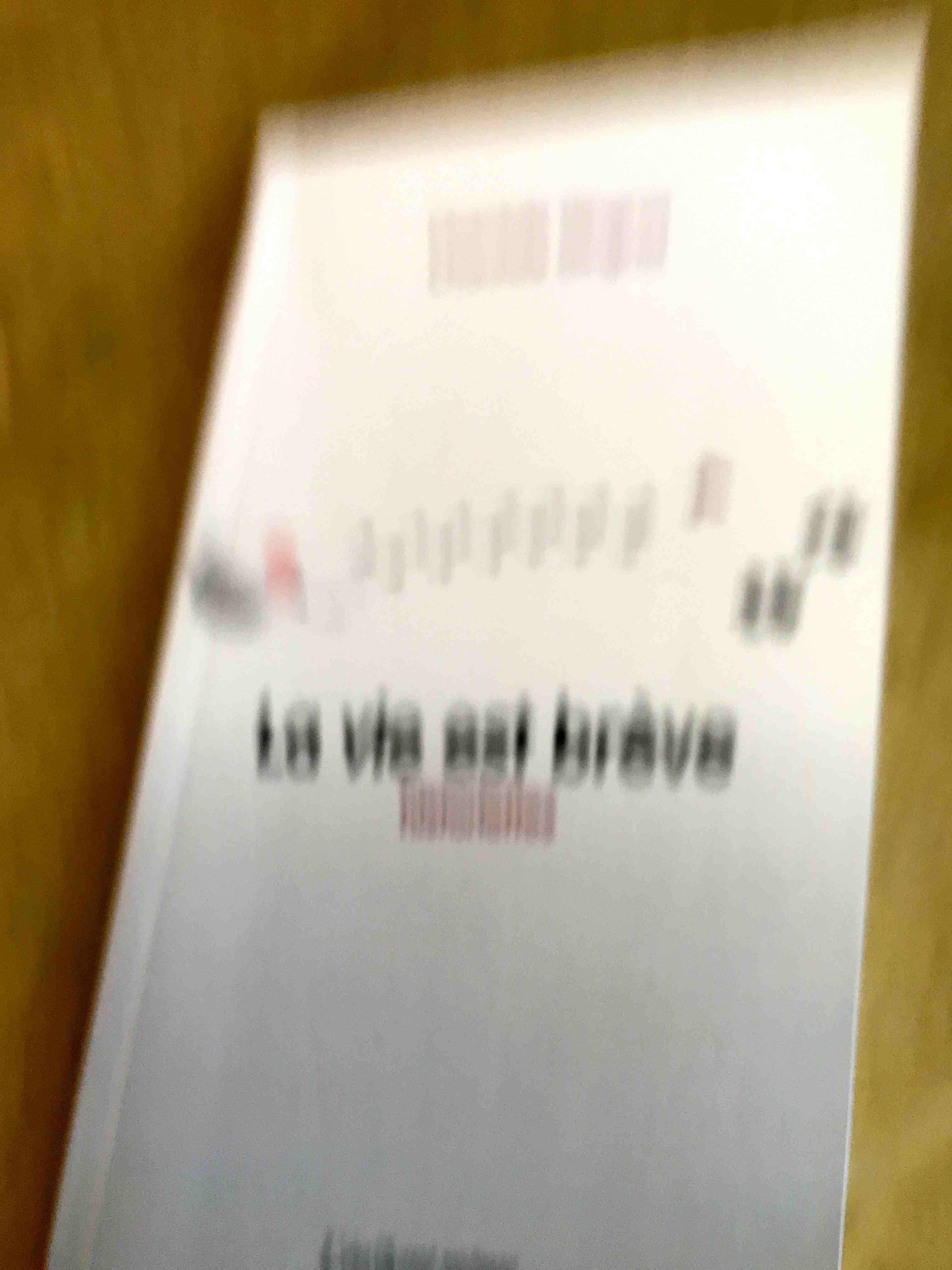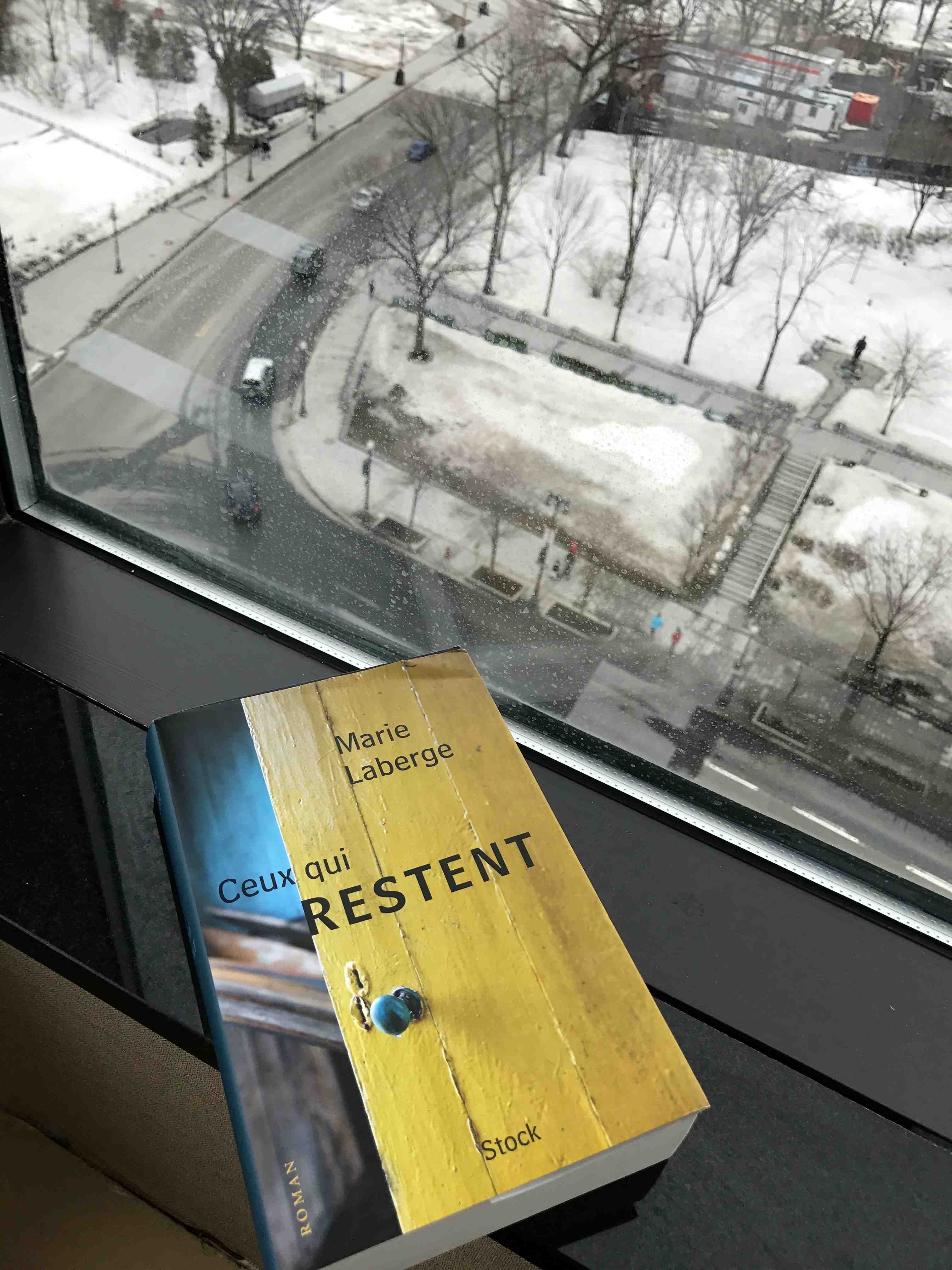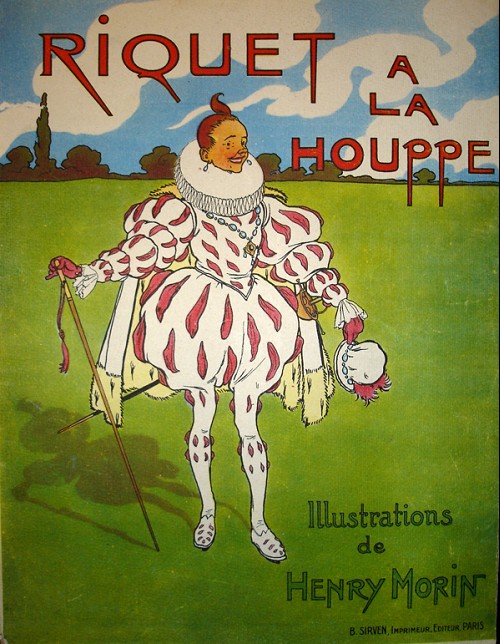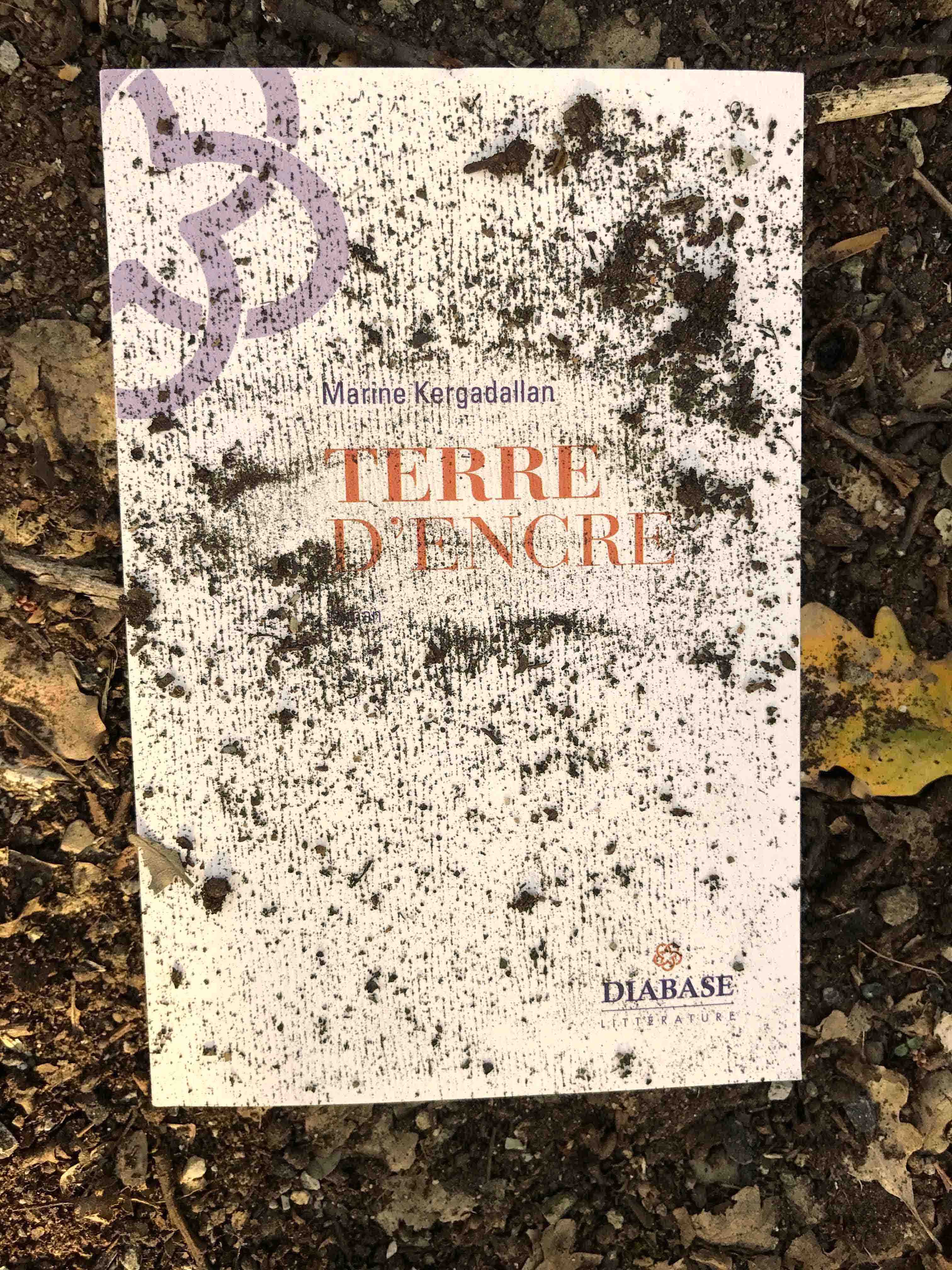
Voici un roman* qui a la densité d’un recueil de poésie, le format d’un bréviaire, la légèreté de quelques soupirs ; voici une poignée de terre humide encore, quelques brins d’herbe que le soleil chauffe à peine ; voici un scooter qui fonce dans les tunnels d’arbres, emportant un écrivain, le conduisant, alors qu’un cerf menace de surgir, dans cette maison centenaire où il va émietter les mots comme on touille une couleur sur une palette ; voici un texte taillé à la poésie, comme les doigts crevassent la glaise, un texte qui germe comme des grains ; voici une magnifique improbabilité, celle d’écrire et celle de vivre, celle de retenir et celle de laisser aller ; voici un livre à la finesse d’une dentelle bretonne, qui couvre et dévoile à la fois la grâce d’écrire et sa volubilité ; voici des mots que le vent emporte, ne laissant que l’immense et magnifique vide des choses à venir.
*Terre d’encre, de Marine Kergadallan. Éditions Diabase. En librairie le 3 mai 2017. Profitez-en pour (re)découvrir son très beau premier roman, Le Ciel de Célestine.
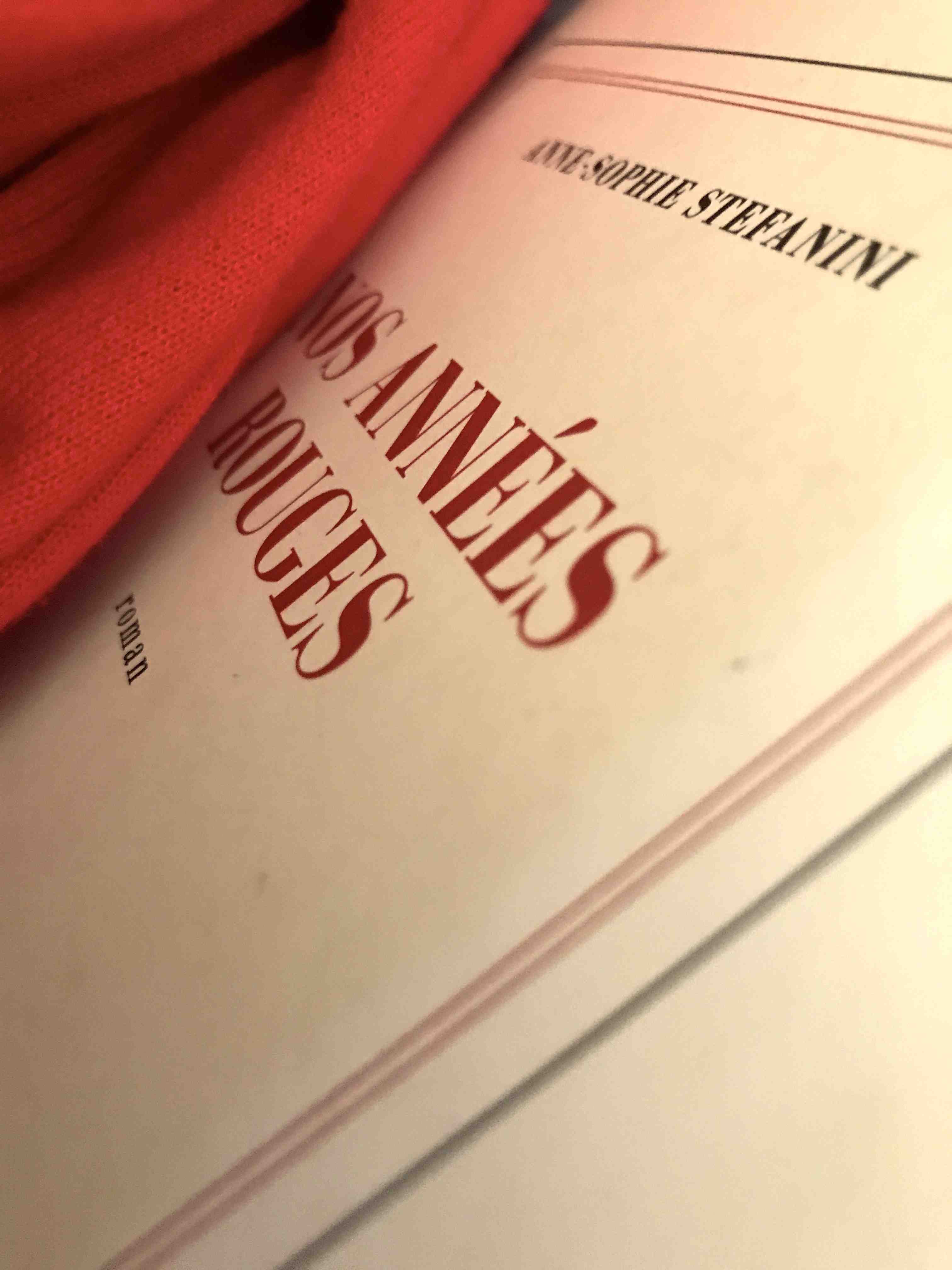 J’aime bien Anne-Sophie Stefanini. Il y a en elle quelque chose des beautés de Raphaël. Une pâleur. Une grâce. Une fragilité forte. Elle est une belle
J’aime bien Anne-Sophie Stefanini. Il y a en elle quelque chose des beautés de Raphaël. Une pâleur. Une grâce. Une fragilité forte. Elle est une belle