Une chanson peut-elle encore, comme l’Homme de Tian’ anmen, dérouter des chars ?

Une chanson peut-elle encore, comme l’Homme de Tian’ anmen, dérouter des chars ?

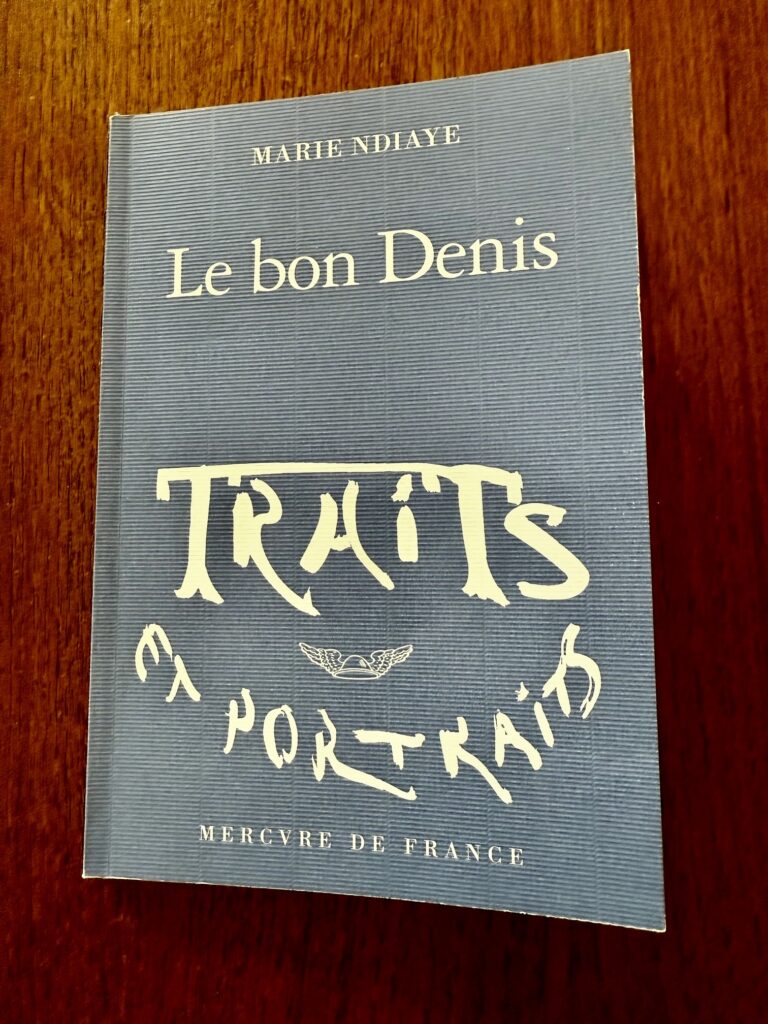
Traits et portraits, merveilleuse collection qui accueillit en son temps Le sens du calme de Yannick Haenel qui m’avait chambardé, reçoit pour la seconde fois, après « Autoportrait en vert » la multi-primée Marie Ndiaye, Goncourt, Mme Figaro, Femina — rien que ça —, laquelle nous offre cette fois quatre nouvelles autour de la figure du père, Le bon Denis, dont une déjà publiée dans le recueil SOS Méditerranée (Folio n° 7146, 2022).
Encore une fois, c’est ici le style, la langue même de Ndiaye qui emporte tout sur son passage et qui séduira davantage les amoureux des jolis mots que ceux des histoires solides. On est là davantage chez Monet que chez Renoir, l’impressionnisme plus que l’expressionisme — ce qui en fait toute sa précieuse élégance mais aussi son souvenir incertain.
*Le bon Denis, de Marie Ndiaye, aux éditions Mercure de France, coll Traits et Portraits, dirigée par Colette Fellous. En librairie depuis le 3 avril 2025.
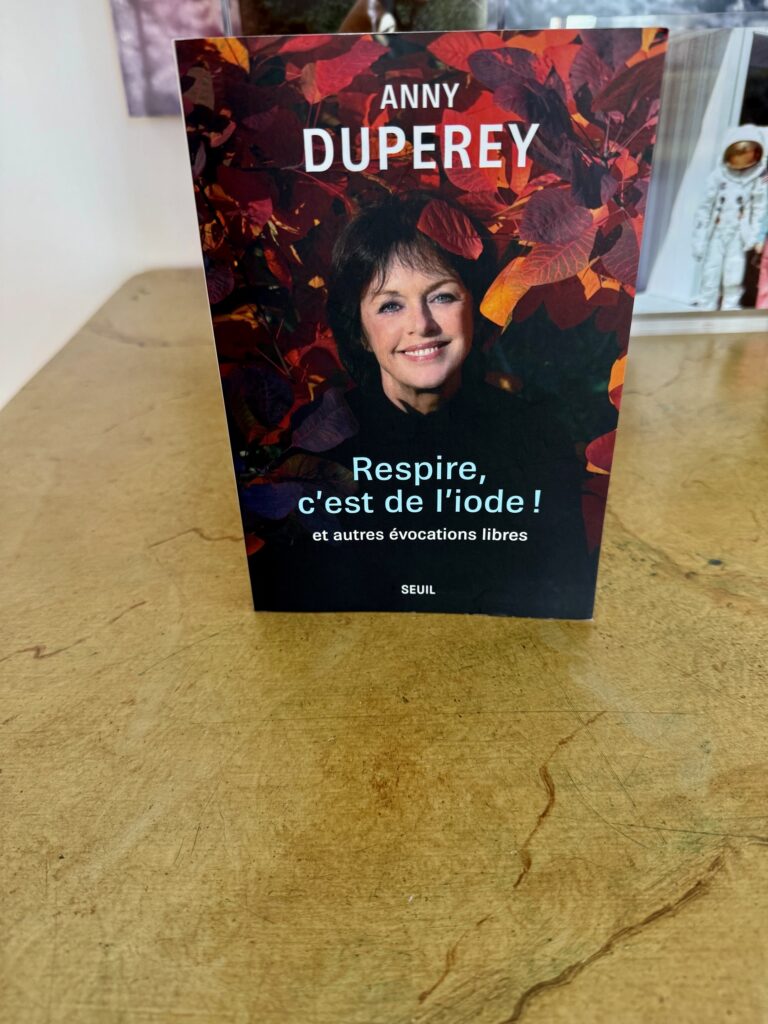
Il y a quelque chose de très léger dans ce petit livre d’Anny Duperey qui commente des phrases qui l’ont marquée — adressées par exemple sur un plateau de cinéma par un Blier au mieux de sa forme ou, dans un musée, par son fils effaré devant une sculpture moderne. On notera avec amusement le Ben dis donc la télé ça arrange balancé à l’actrice non maquillée dans une superette ou le Mais suce-la, bon Dieu, suce ! de Claude Berri, sur le tournage de Germinal, mais tout cela est bon enfant, à l’image de l’inusable (pour preuve la photo de la couverture) vedette d’Un éléphant ça trompe énormément et se lit sans y penser comme on suce une glace l’été sur la plage.
*Respire, c’est de l’iode ! et autres évocations libres, de Anny Duperey aux éditions du Seuil. En librairie depuis le 11 avril 2025.
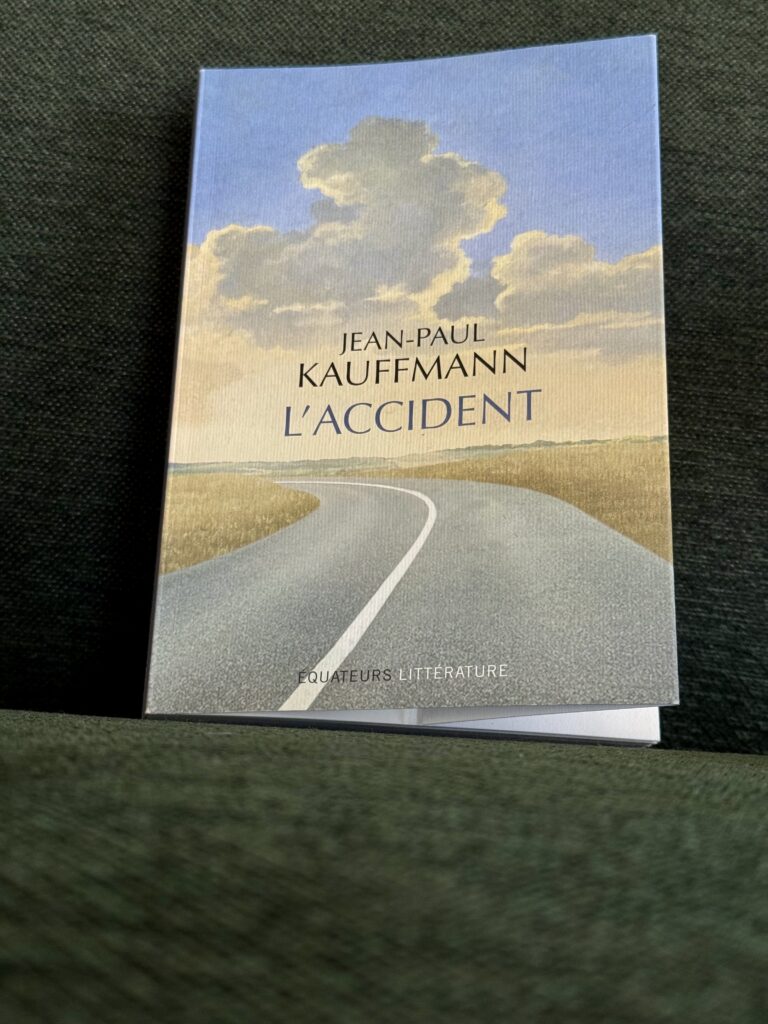
Jean-Paul Kauffmann se souvient*. Non pas de son enlèvement au Liban le 22 mai 1985, mais de l’accident du 2 janvier 1949, dans son petit bourg de Corps-Nuds (Ille-et-Vilaine) — un gamin bourré qui s’en revient d’un match de football avec vingt-cinq personnes à l’arrière de son Dodge 60, fonce, rate un virage sévère, le camion explose le parapet, s’enfonce dans l’eau boueuse, les arceaux qui retiennent la bâche décapitent bon nombre des footballeurs ; dix-huit morts.
C’est à partir de ce fait divers pour lequel le conducteur pochtronné prendra à peine un an de prison et 1200 francs de l’époque, que Kauffmann revisite son enfance. « (…) vingt jours après la fin du confinement, j’ai commencé ce livre sur les années 50 » (page 141).
Se déroule alors une sorte de pêle-mêle, de courts chapitres sur l’église de son village, le clocher de l’église, la boulangerie familiale, les professeurs du pensionnat, le curé du village, les bondieuseries, le maire, puis la mairesse, puis les livres lus, puis, parfois, un souvenir de captivité au Liban, puis sur une toile de Poussin, sur la nostalgie qui imprègne, inonde tout, bien qu’il s’en défende (« Je n’aime pas la nostalgie, cette mélancolie complaisante »), comme ce chapitre consacré au buvard d’écolier et aux tâches d’encre, au désir immobile d’une certaine Berruyère, aux cinq sens et à son amitié profonde pour le bordeaux ; L’Accident est un retour désordonné sur les lieux de l’enfance, comme on revient dans un pays détruit où l’on n’a plus vraiment sa place.
*L’Accident, de Jean-Paul Kauffmann, aux éditions Équateurs. En librairie depuis le 19 février 2025. Prix Marcel-Pagnol 2025.
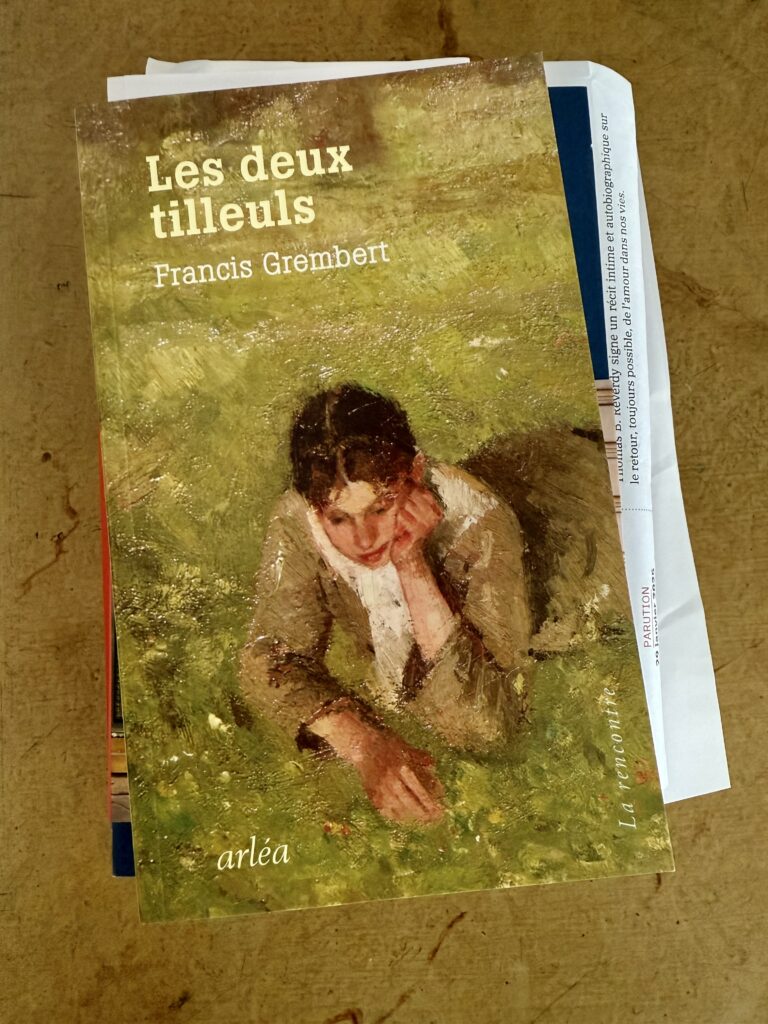
Les années 60. Le Nord de la France. La campagne. Des odeurs de printemps et de purin. La ferme. Le temps qui s’étire et baille et tourne parfois à l’orage ou aux brûlures du soleil. Des poules, des vaches et du lait. Des corps forcis, fatigués déjà. Et dans cette pastorale, deux enfants, deux frères, François, 4 ans, Francis, 7 ans, et un jour une automobile écrase le petit. Pas de cris, pas de hurlements ; une fatalité grise, juste un petit corps sur un petit lit, puis sur un petit lit d’hôpital, puis dans une petite boite, et voilà le cœur du petit survivant qui grandit, grandit, pour y accueillir le souvenir de son petit frère, faire place à cette vie dans les champs qu’ils se promettaient, y ranger les mots des grands qu’on comprendra un jour, comme mort et comme mot — juste une lettre d’écart —, comme disparu, comme chagrin. Et c’est le Francis de soixante ans qui écrit aujourd’hui cette tragédie lointaine, le silence des arbres encore, le parfum oublié des tilleuls, lui, le survivant, l’écrivain, Francis Grembert qui, à son tour, bèche le plus beau des jardins du souvenir à son petit frère.
*Les deux tilleuls, de Francis Grembert, aux éditions Arléa, coll La rencontre. En librairie depuis le 2 janvier 2025. Prix du livre court 2025. Prix Cazes 2025.

Superhôte, c’est la note maximale qu’un loueur d’Airbnb peut espérer obtenir, mais c’est aussi le titre de ce nouveau roman* d’Amélie qui nous entraine dans une location de courte durée au Touquet en suivant la vie d’une femme de l’ombre : la femme de ménage. Ramasseuse de merde. Nettoyeuse de vomi. Aspiratrice de poussières et autres mochetés. Rangeuse de tout. Flingueuse d’araignées, mites et tiques. Femme qu’on siffle au dernier moment pour rendre à l’appartement tout son lustre et qui voit défiler toutes sortes de gus, jusqu’au jour où l’un d’entre eux, par ricochet, déclenche l’irréparable.
Superhôte est formidablement jouissif, démarre sur les chapeaux de roues, style alerte, esprit, humour, cynisme, et soudain bascule dans le drame, l’émotion, la noirceur, l’immense bêtise des hommes.
Et ça, ça vaut bien une supernote.
*Superhôte, d’Amélie Cordonnier, aux éditions Flammarion. En librairie depuis le 26 mars 2025.
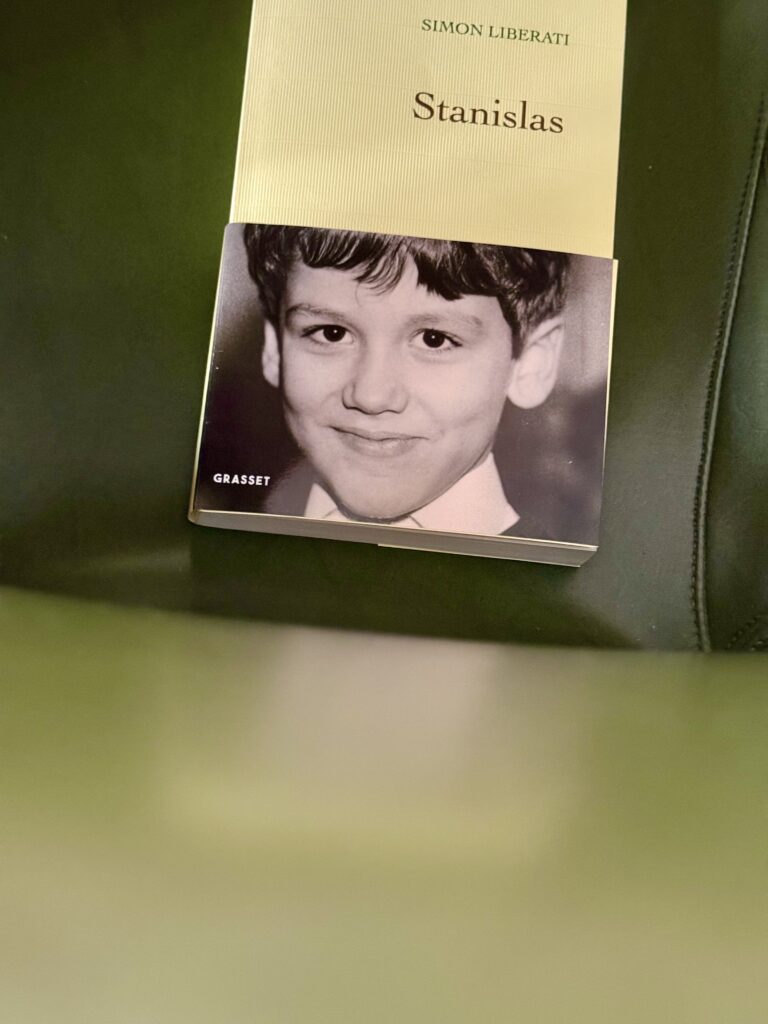
À la page 200 de son récit*, Simon Liberati écrit : « Je n’étais pas ambitieux. Je voulais être célèbre ».
Alors le gars s’est mis à écrire des romans sur des gens célèbres, Jayne Mansfield, Brian Jones, Irina Ionesco, Sharon Tate, etc, selon l’idée un brin naïve qu’en côtoyant, même fictivement, des célébrités, on en devient soi-même une.
Et le voilà cette fois qui s’attaque à une autre vedette — lui-même — en racontant ses années au collège Stanislas comme on raconte la vie d’un autre qui mérite un livre. On y découvre un impressionnant catalogue de « name dropping », la liste des livres qu’il a lus, de larges extraits de ceux-ci, l’annuaire de ses professeurs, les musiques qu’il a écoutées, ses plaisirs solitaires plus jouissifs qu’une fille, puis les filles qui n’a pas eues, celles qu’il a eues, et pour faire bon genre, un peu de harcèlement scolaire qu’on appelait autrement à l’époque.
Je ne sais pas si Liberati a atteint son fantasme de célébrité mais en refermant ce bref récit je n’ai pas pu ne pas penser à ce que répondit vainement Kim Kardashian lorsqu’on lui demanda de quoi elle était célèbre :
— D’être célèbre.
*Stanislas, de Simon Liberati, aux éditions Grasset. En librairie depuis le 26 février 2025.
Voilà longtemps que l’on m’avait dit que ce Musso-là n’avait rien à envier à l’autre, bien au contraire même (sauf peut-être quelques dizaines de millions d’euros à la banque) et voici que son dernier livre* m’a été offert au Festival du livre de Nice et qu’à la faveur d’un retard de trois heures du vol Nice-Paris, j’ai lu d’une traite.
Voici demain est une formidable nouvelle qui a, selon moi, le défaut d’être étirée sur 250 pages — mais faire court demande tant de temps et d’efforts —, qui se situe dans une ferme des Pyrénées où deux enfants, baignés d’idéologie survivaliste transmise par leur père, tentent de survivre seuls après la pandémie. L’ambition lorgne du côté du McCarthy de La route ou du Collette de Et toujours les forêts sans toutefois en atteindre encore ni la puissance ni la grâce, même s’il y a chez ce frère un authentique style pétri de simplicité, d’efficacité, partant, une vraie personnalité.
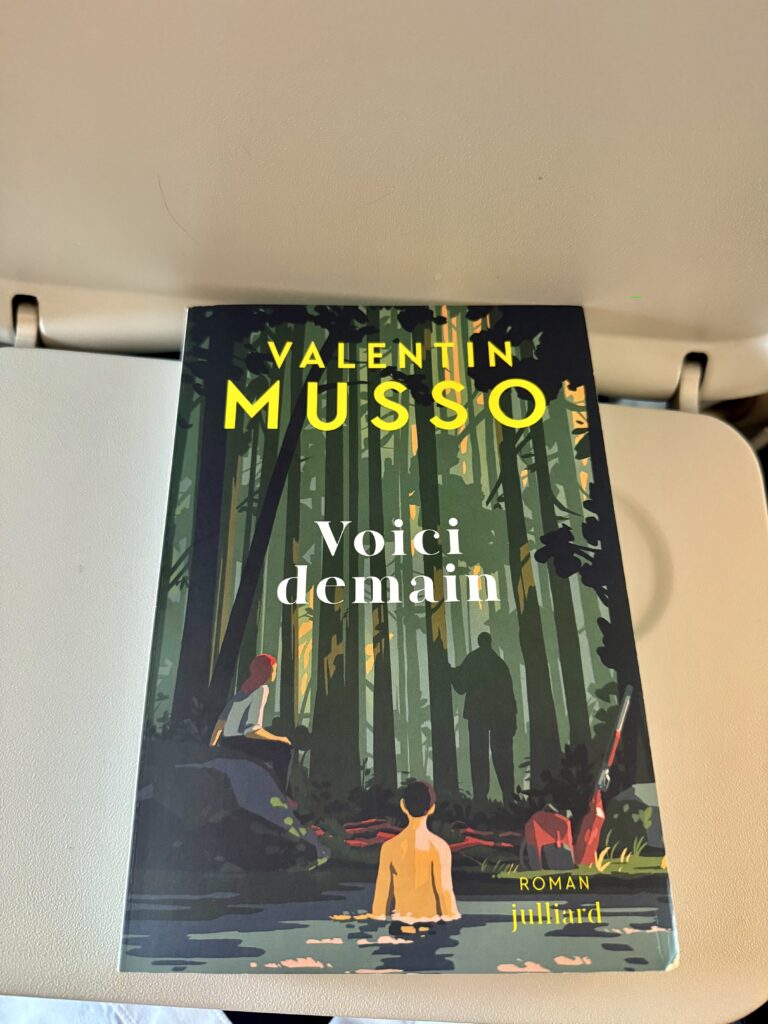
*Voici demain, de Valentin Musso, aux éditions Julliard. En librairie depuis le 15 mai 2025.