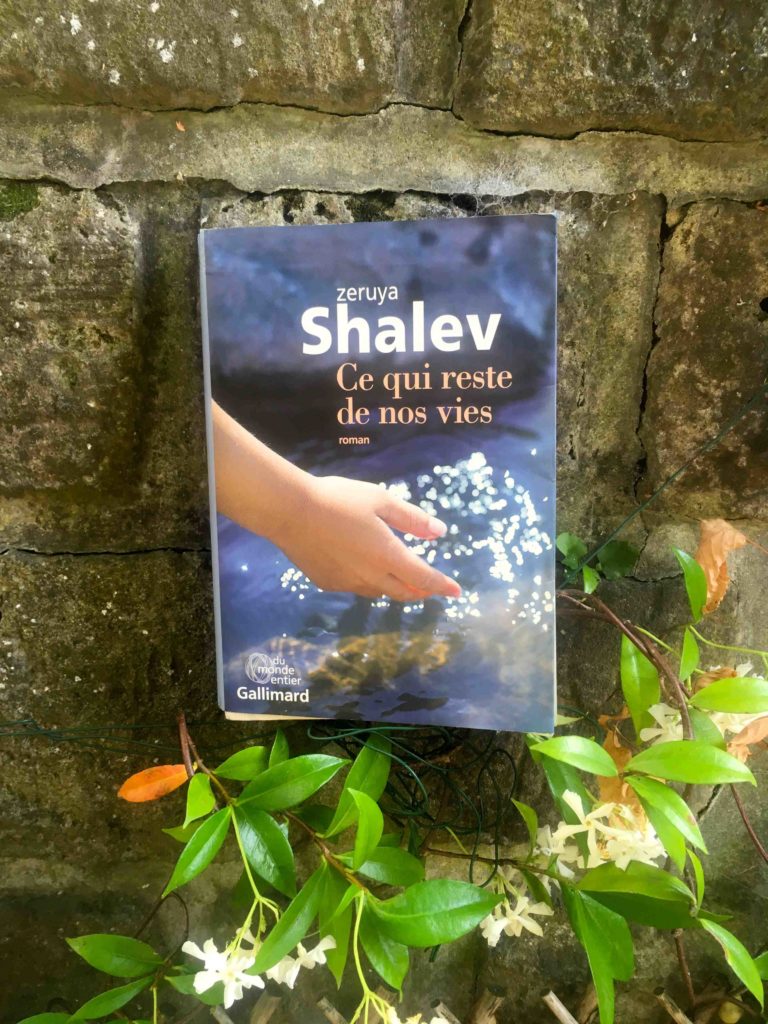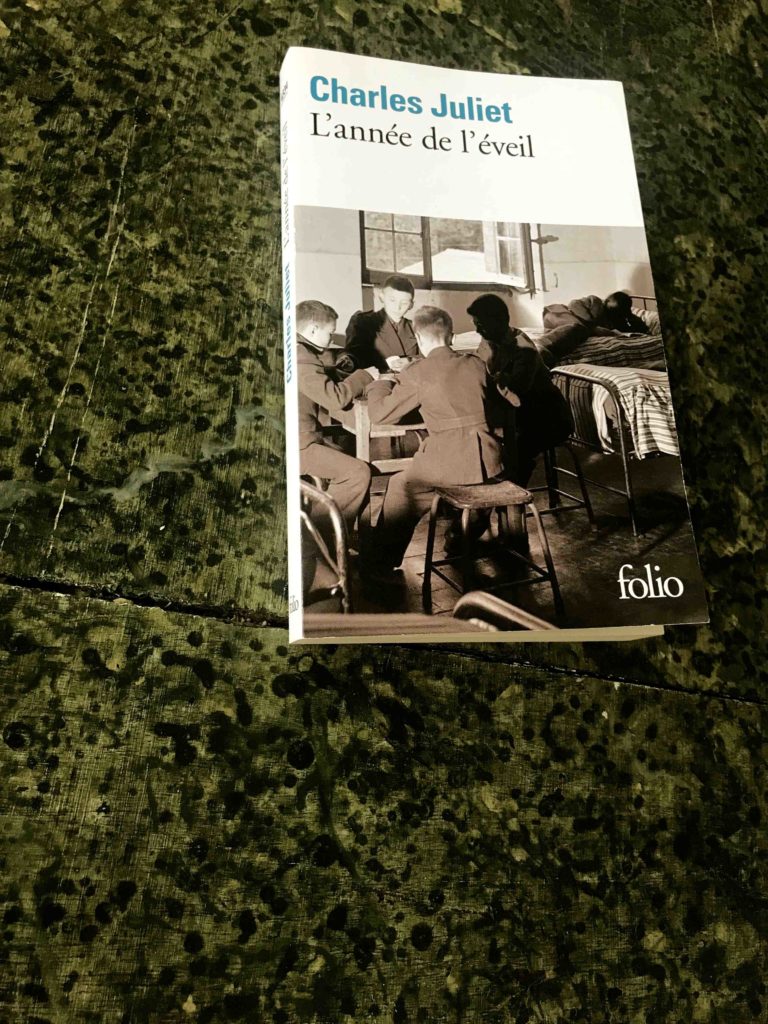Voici un livre que je me promettais de lire depuis bien longtemps, depuis que j’ai lu le formidable Into the wild écrit par Jon Krakauer d’après le récit autobiographique de Christopher McCandless et dont Sean Penn avait tiré un fort beau film en 2007. Eh bien c’est chose faite. Je viens de le savourer au pays même où il fut écrit, à sept cents miles environ de là où il fut vécu et je le referme non sans une douce mélancolie à l’heure où l’écologie est en passe de devenir une sorte de nouveau terrorisme et le véganisme une religion intolérante, car Thoreau démontre avec une poésie délicieusement surannée (à laquelle la traduction délicieusement surannée de Louis Fabulet rend hommage) que la recherche du bonheur respecte nécessairement la vie dans les bois, le temps des saisons, la pluie, le vent, les récoltes, la beauté d’une aube, l’élégance d’un crépuscule. Il n’est de retrouvaille de soi que dans la paix et le respect, et si ces notions peuvent sembler un tantinet désuètes, jamais preuve n’a encore été apportée qu’elles ne sont pas justes, alors j’ai pensé, en refermant ce livre au mal que nous nous faisions tous les jours, par ignorance de la chance que nous avions d’être là, vivants, par égoïsme ou par désinvolture et j’ai commencé par recycler ce livre en l’offrant à un inconnu qui s’apprêtait, West Avon Rd, Rochester Hills, Michigan, à monter à bord de son gros truck Ford F250.
*Walden ou la vie dans les bois (1854), de Henri David Thoreau. Éditions Albin Michel, coll « Spiritualités vivantes » (hum, hum), traduction délicieusement surannée de Louis Fabulet, laquelle, dit-on, lui aurait pris sept ans, soit le même temps qu’il a fallu à Thoreau pour l’écrire.