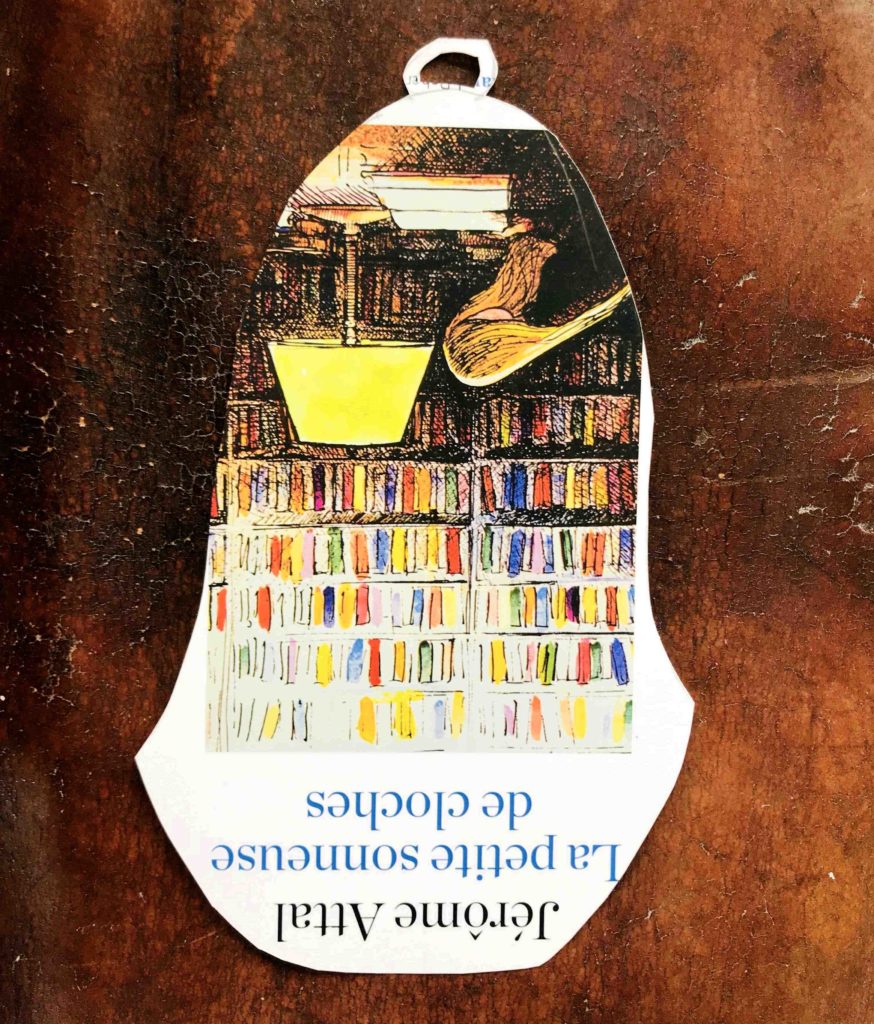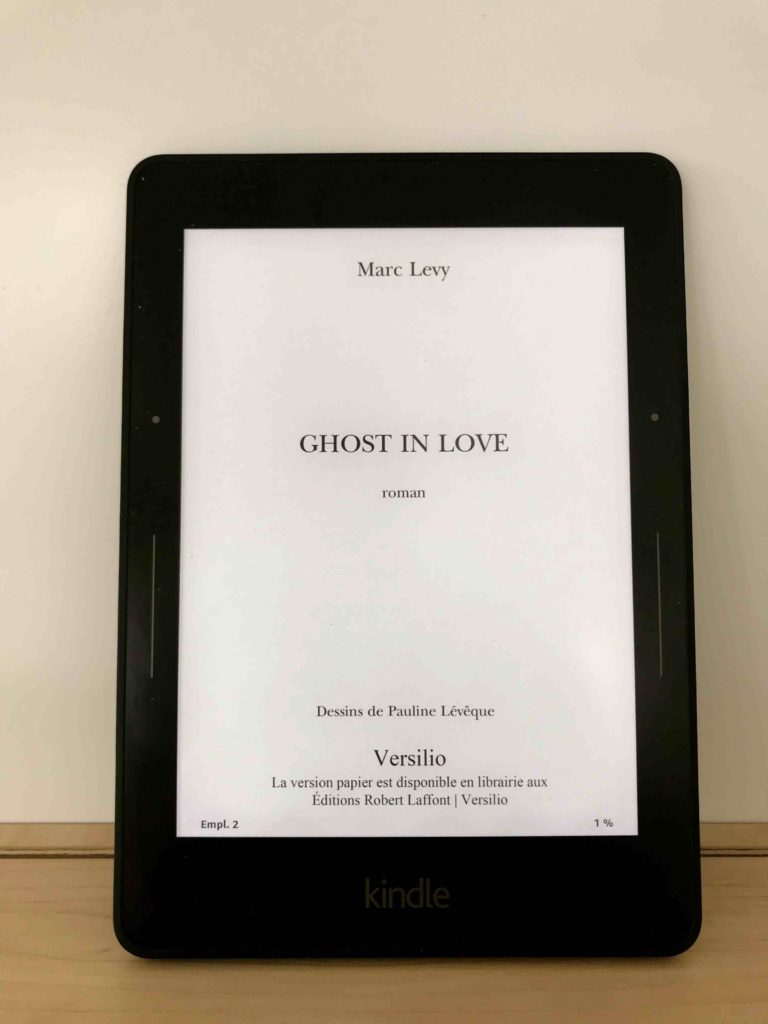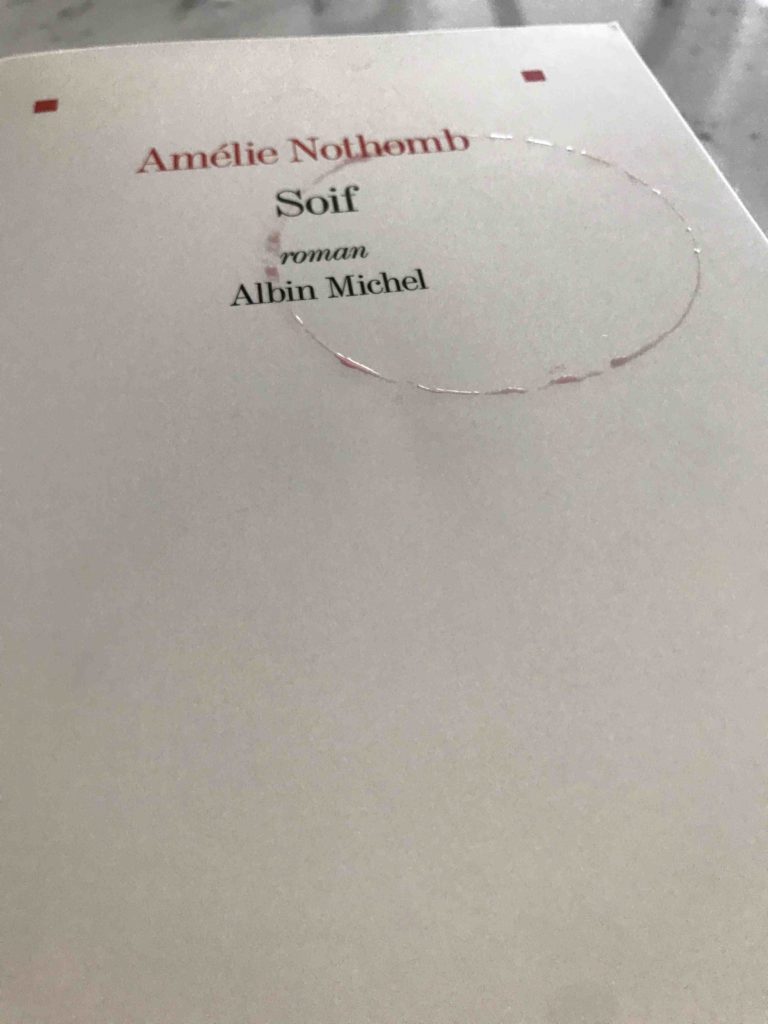
Ainsi donc, après avoir repris les histoires de Barbe Bleue et de Riquet à la houppe, voici que Amélie Nothomb s’empare des dernières heures de la vie terrestre de Jésus et nous raconte*, à la première personne (il est vrai qu’on ne peut faire moins quand on est Jésus), sa crucifixion avec des envolées dignes du facétieux Jean-Louis Fournier** : Franchement, là, si je voulais ressusciter, j’en serais incapable pour une raison simple : je suis épuisé. Mourir fatigue (page 121).
Je ne sais s’il s’agit là d’un roman ou d’une pochade***, mais à l’évidence d’un très court texte autour de l’idée que la soif, « ce gobelet d’eau » qu’on porte à ses lèvres assoiffées quand on a soif, c’est Dieu.
À peine commencé, le texte se termine (il est très court, je vous l’ai dit), sur cette constatation implacable : Au commencement, je croyais à la possibilité de changer l’homme. (…). Les gens changent seulement si cela vient d’eux et il est rarissime qu’ils le veuillent réellement (page 150). Je suis donc resté un peu sur ma faim – enfin, ma soif – avec ce texte certes bien agréable à lire comme toujours chez Amélie, et, le reposant, me suis demandé si je n’avais pas raté quelque chose. Aussi, comme en vérité il est dit que Dieu n’abandonne jamais ses ouailles, je le relirai dans quelques temps, en espérant qu’il sera cette fois mon Buisson Ardent, ma rencontre divine sur le chemin de Damas – comme il l’a été pour Bernard Pivot qui est allé jusqu’à parler de « résurrection de Nothomb ». Qui du coup, l’a inscrite sur la liste du Goncourt. Un véritable miracle, en somme.
*Soif, de Amélie Nothomb, 152 pages. Éditions Albin Michel. En librairie le 21 août 2019. Rentrée littéraire 2019 (comme chaque année depuis 27 ans).
**Le C.V de Dieu et Satané Dieu ! de Jean-Louis Fournier, tous deux au Livre de Poche
*** « Œuvre littéraire écrite rapidement – parfois de façon burlesque », selon les dictionnaires. (À ne pas confondre avec pochetronnade).