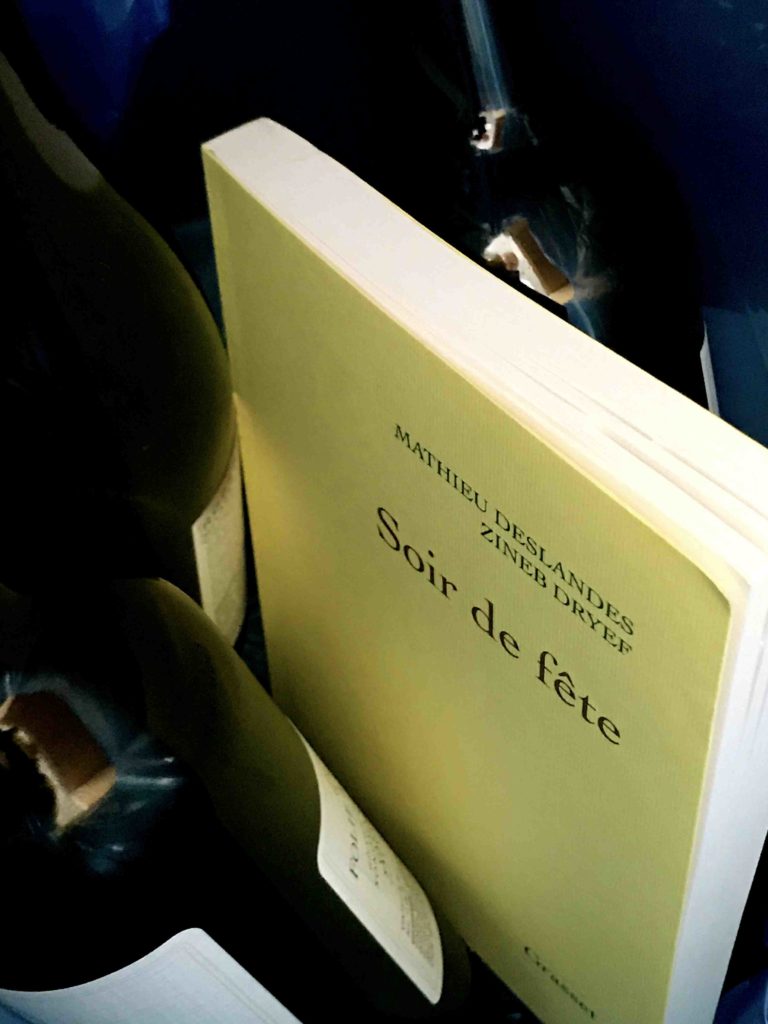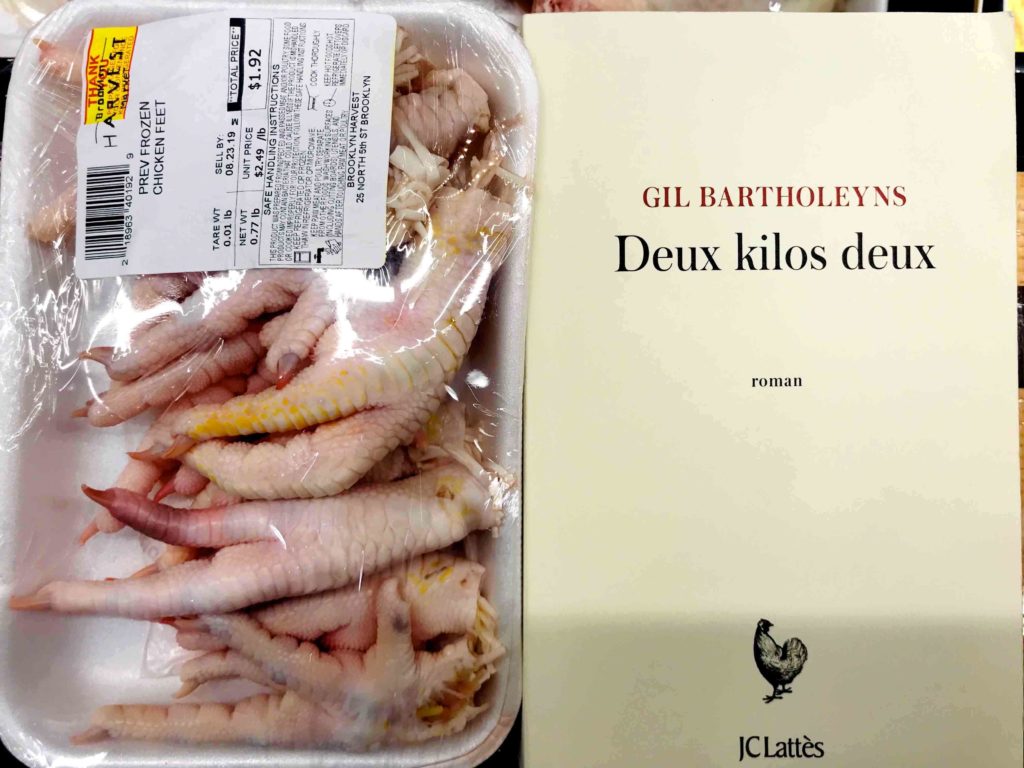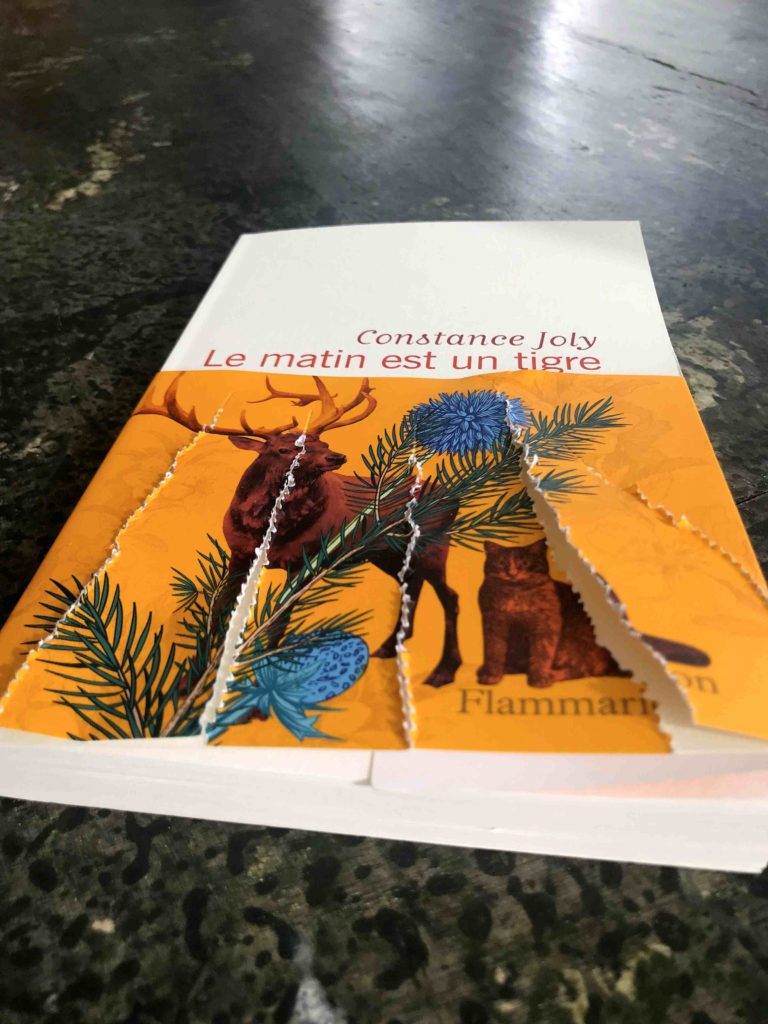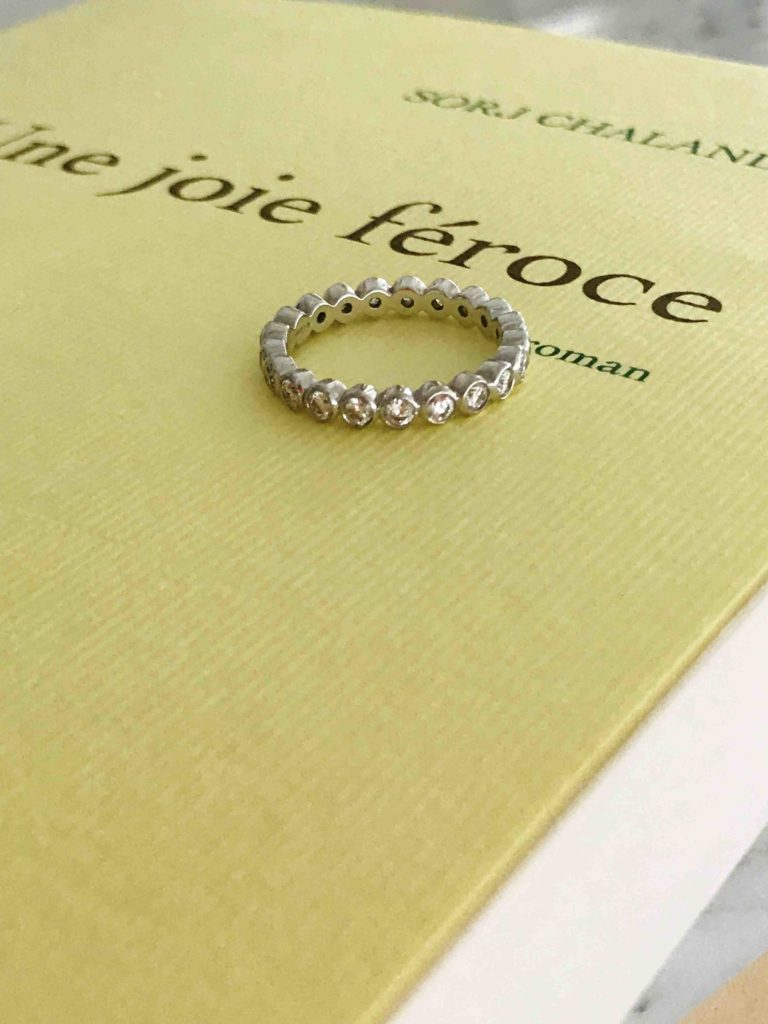Je suis émerveillé par la quantité de votre production : 27 livres en 19 ans, en comptant les livres jeunesses qui, s’ils sont un peu plus courts que les romans dits adultes, n’en sont pas moins de vrais livres, émerveillé car je me demande comment vous faites pour trouver le temps de respirer, de savourer, de goûter aux lenteurs, aux langueurs du temps, pour encore écouter des autres battre le cœur, entendre les grondements sourds, parfois furieux, de leurs sangs, comme celui des vagues, mais depuis que je me suis laissé dire, à tord peut-être puisque vos livres qui mettent en scène ce double de vous triste, Paul Lerner, brouillent joyeusement les pistes avec votre vraie vie, la moquent même, depuis donc que je me suis laissé dire que vous habitiez à quelques pas de la mer, en Bretagne, là où le temps et l’espace sont différents, là où ils confinent parfois au grand silence, j’ai pensé que c’était peut-être ce grand silence que vous cherchiez à remplir avec vos craintes, avec vos doutes, vos incessants questionnements, ces litanies, comme un ressac, sur le chagrin d’un écrivain qui chute, d’un homme qui s’affaiblit à lui-même et que, dès l’instant où vous teniez un clavier sous vos doigts, vous vous sentiez obligé, par instinct de survie probablement, de gaver ce silence, comme on gribouille un vide, pour n’être plus jamais seul, n’avoir plus froid peut-être, ce qui vous amène à écrire des phrases longues, si longues, que mes yeux s’épuisent à y chercher un point, ne serait-ce qu’un point virgule ; allez, même trois petits points de suspension… un endroit où reprendre mon souffle, car je suis un lecteur du soir, un lecteur d’avant la nuit, et vos si longues digressions ne parviennent pas à s’y opposer, du coup je m’endors avant la fin de votre phrase et c’est dommage, car elle contient des jolies choses, vraiment dommage car le lendemain je dois la reprendre, retrouver le fil, et le même phénomène se reproduit, et ainsi de suite, aussi, vais-je laisser provisoirement de côté votre Partie de badminton* – dont je crois savoir qu’un échange dure en moyenne sept secondes, donc combien d’échanges contient votre phrase ci-dessous ? –, la reposer là, cette Partie, à la page 161, là où j’en suis, au moment où « une sonnerie stridente tire [Paul Lerner] du sommeil » et paradoxalement m’y plonge, moi, dans le mien de sommeil, et reviendrai vous dire tout le bien que je pense de votre nouveau roman lorsqu’un matin cette fois, je l’aurai achevé, et non pas le contraire.
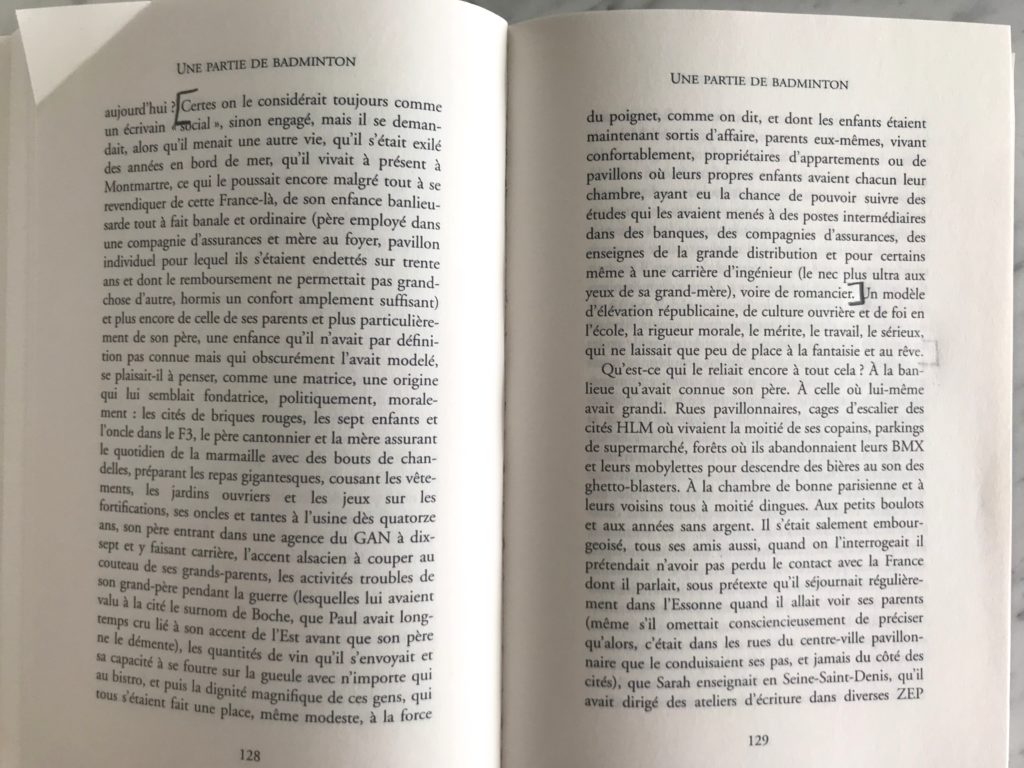
*Une partie de badminton, d’Olivier Adam. Éditions Flammarion. En librairie le 21 août 2019. Rentrée littéraire 2019.