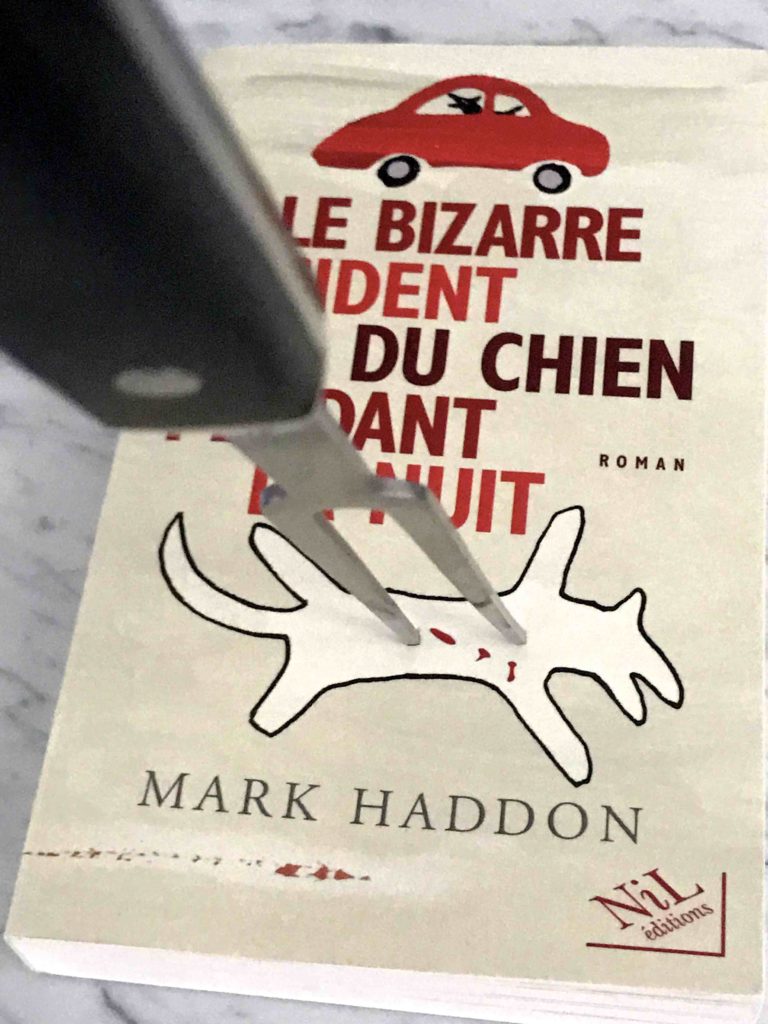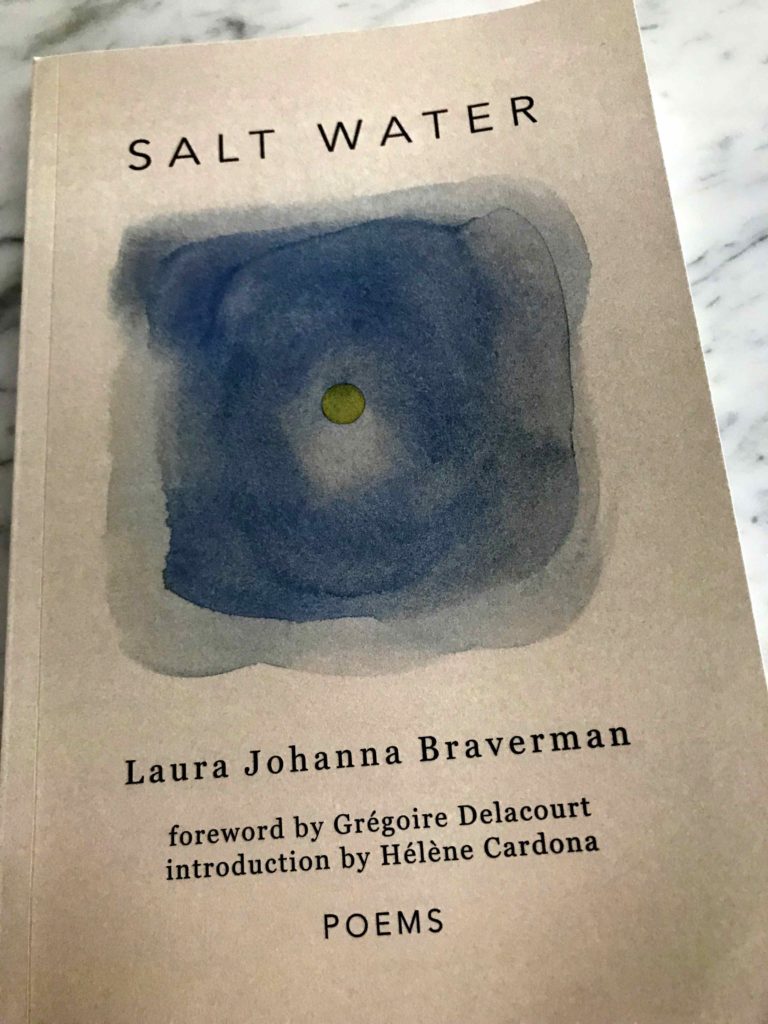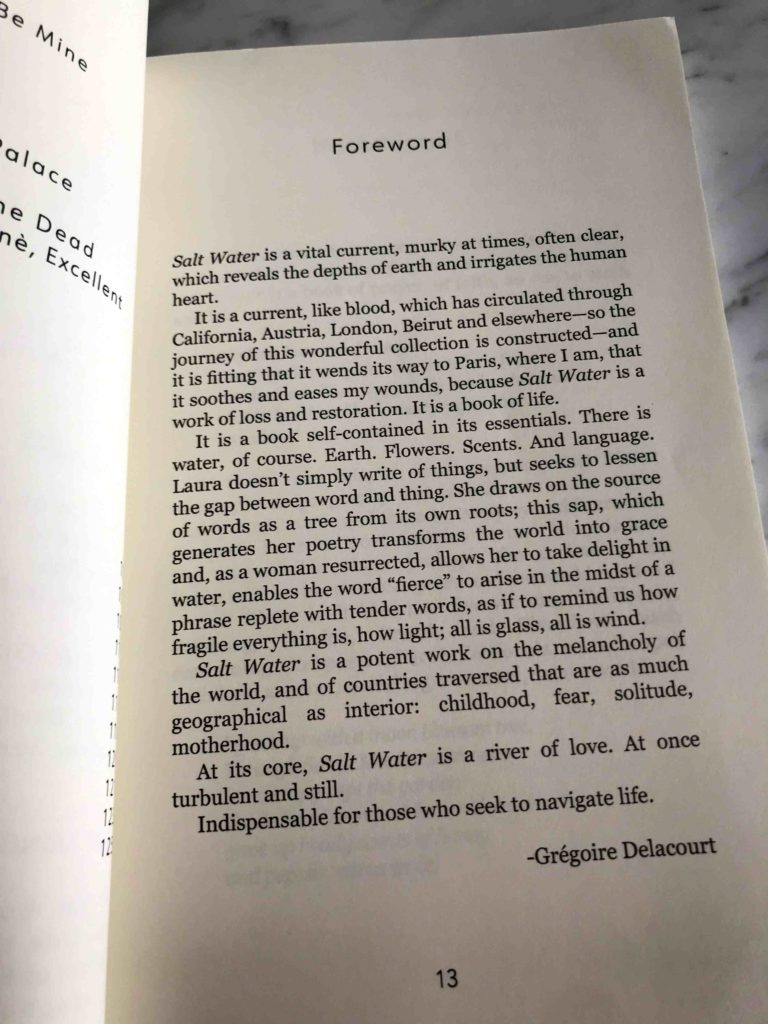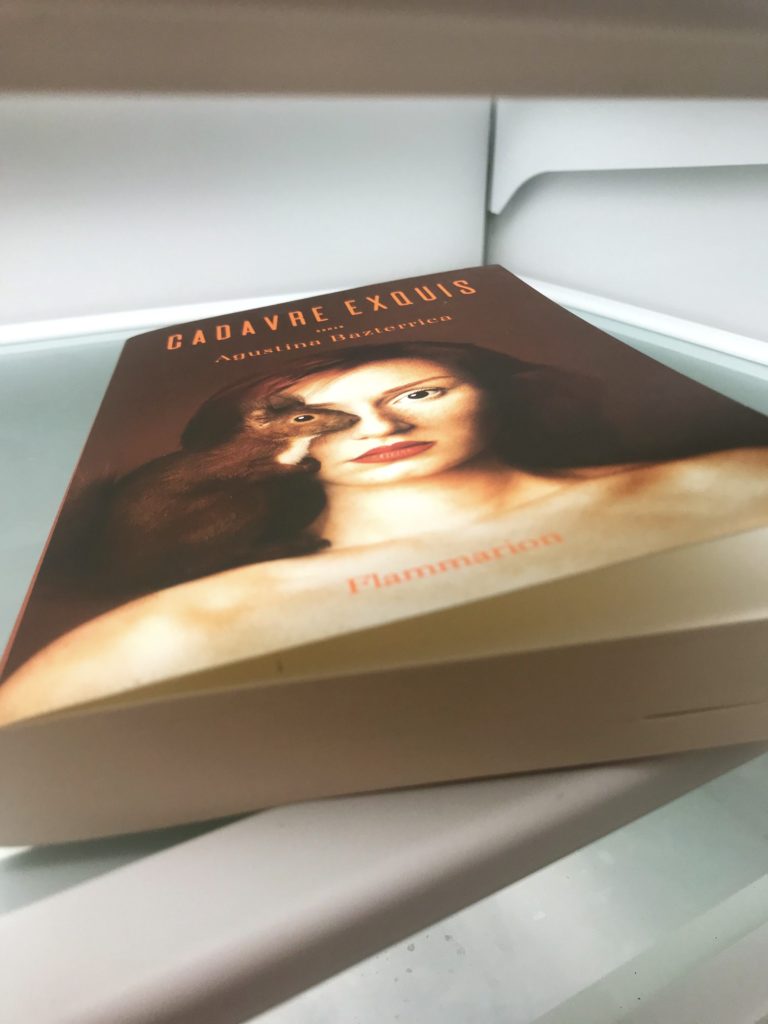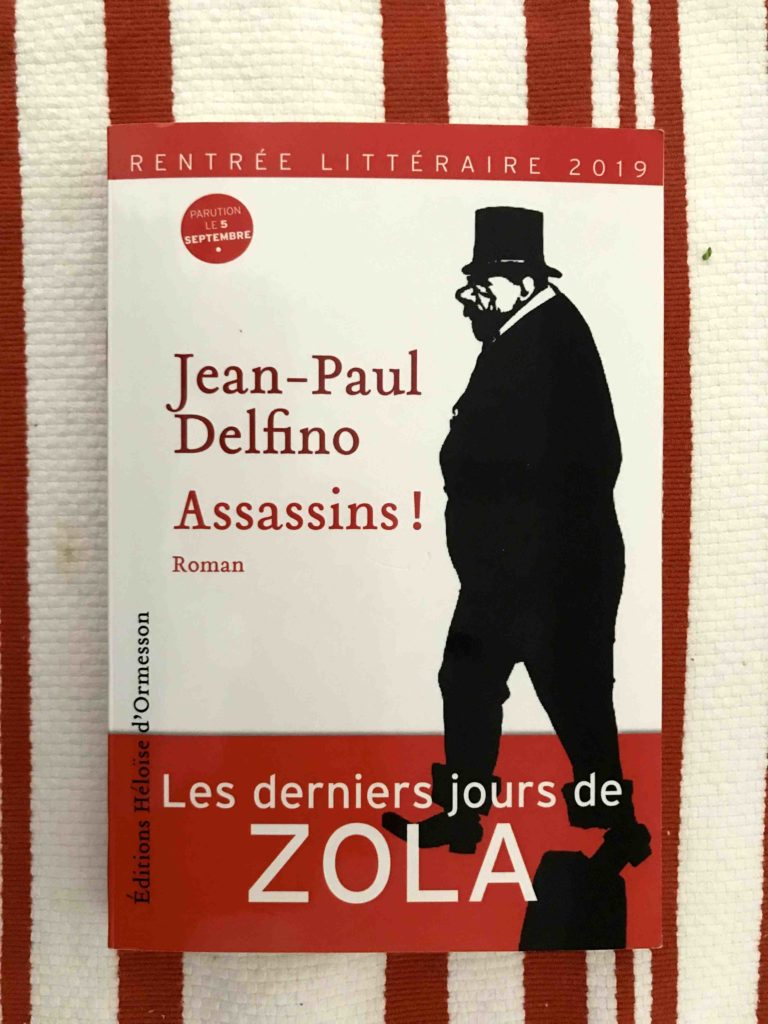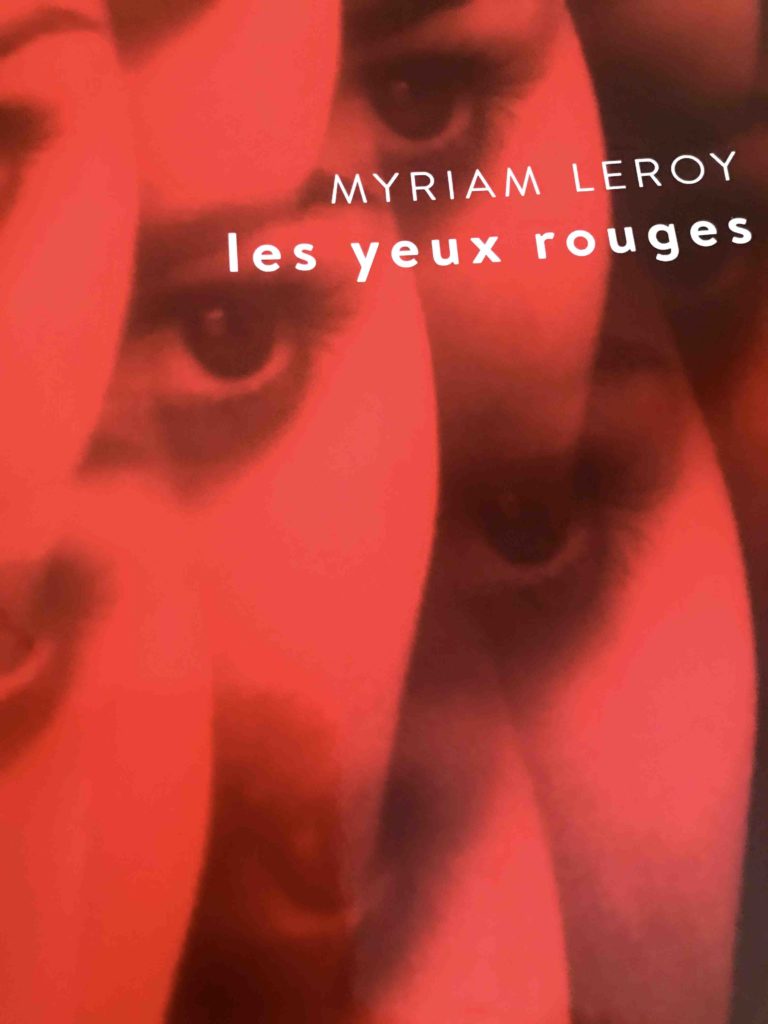
Avant ce deuxième livre, Myriam Leroy fut finaliste du Goncourt du premier roman*, ce qui n’est jamais anodin dans le genre « entrée par la grande porte » dans un monde qui les claque si vite. C’est dire si j’attendais ce nouveau texte** avec curiosité, publié au Seuil cette fois, dans la prestigieuse collection Cadre rouge. Et ma curiosité n’a pas été déçue. Voici une littérature nouvelle génération, qui écrit LOL, PTDR, emoji caca, emoji baiser, MDRrait, comme on écrivait avant « Il lui fit porter un télégramme », « Il éclata soudain d’un rire tonitruant », ou autres choses, et qui raconte le harcèlement facebookien d’abord, puis twitterien dont est victime la narratrice, une gauchiasse (je cite) de journalope (je cite toujours) de radio, par un certain Denis dont elle a refusé les avances sur les réseaux sociaux. De blagues de mauvais goût à l’injure, il n’y a qu’un clic. Un autre clic de l’injure à la cruauté. Les clics sont des balles. Et les balles tuent. En l’occurrence, la narratrice. (Ceci dit, tout cela est connu depuis bien longtemps – combien de gamins se sont déjà suicidés, sans qu’on n’y fasse rien ?). Mais, parce qu’il y a un petit mais dans mon enthousiasme, sous prétexte de dénoncer le mal fait aux femmes par ces réseaux masqués, dans une écriture déroutante (« Pfiooou, j’étais pas dans la merde. Il ne savait pas ce que je lui avais fait mais le Denis avait un putain de dentier contre moi » – page 94), Myriam Leroy finit par trop charger la mule et opposer deux personnages tous deux bien désagréables, ce qui rend un peu vain son plaidoyer, malgré un improbable retournement final. (PS pour les lecteurs impatients : Vous pouvez commencer le livre à la page 156, là où débute la nouvelle intitulée « Les yeux rouges » et qui résume parfaitement les 155 précédentes pages. Une sorte de Si vous avez raté le début). Quoiqu’il en soit, voici un auteur à suivre.
*Ariane, aux éditions Don Quichotte (2018) et Points n° P5008.
**Les yeux rouges, de Myriam Leroy. Éditions du Seuil. En librairie depuis le 14 août 2019.