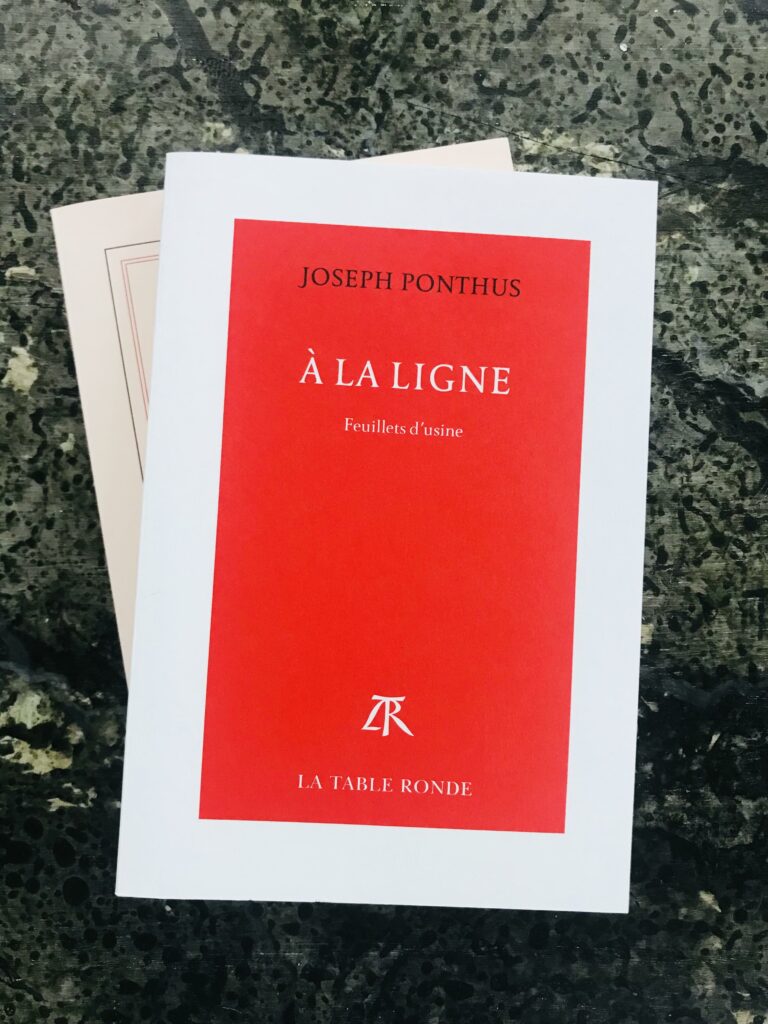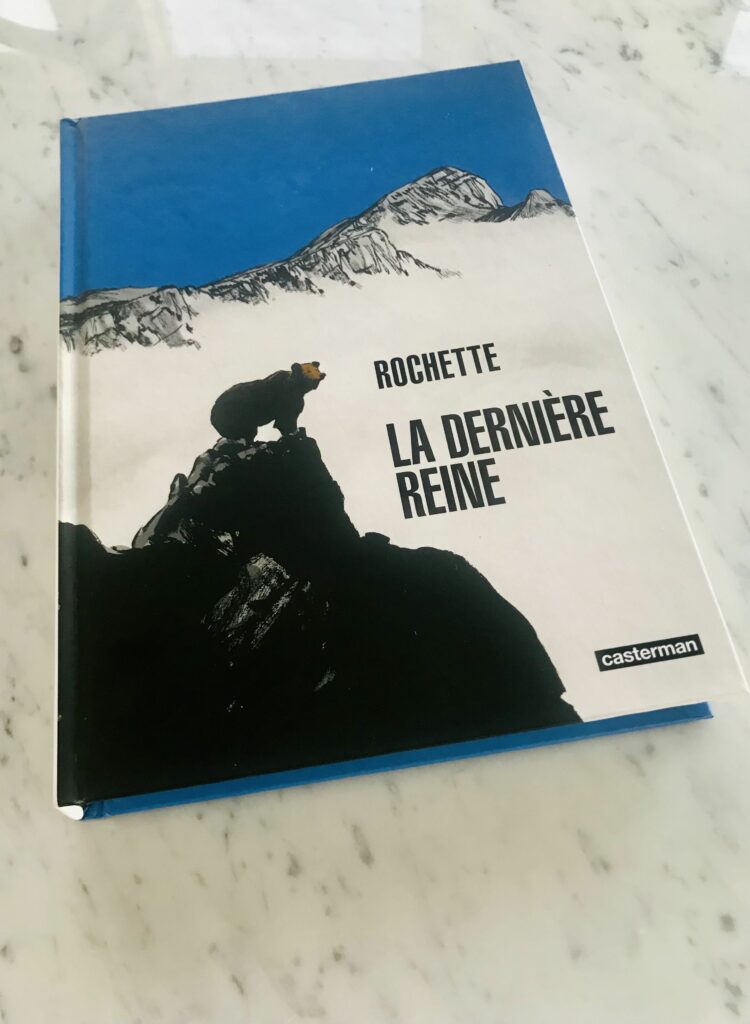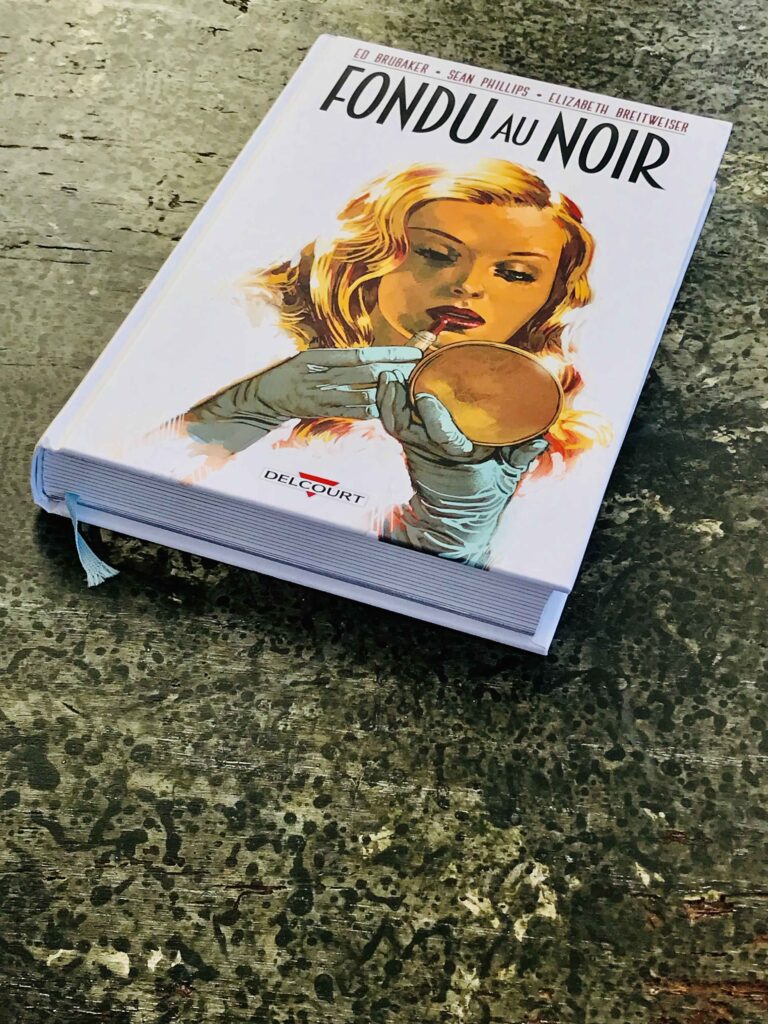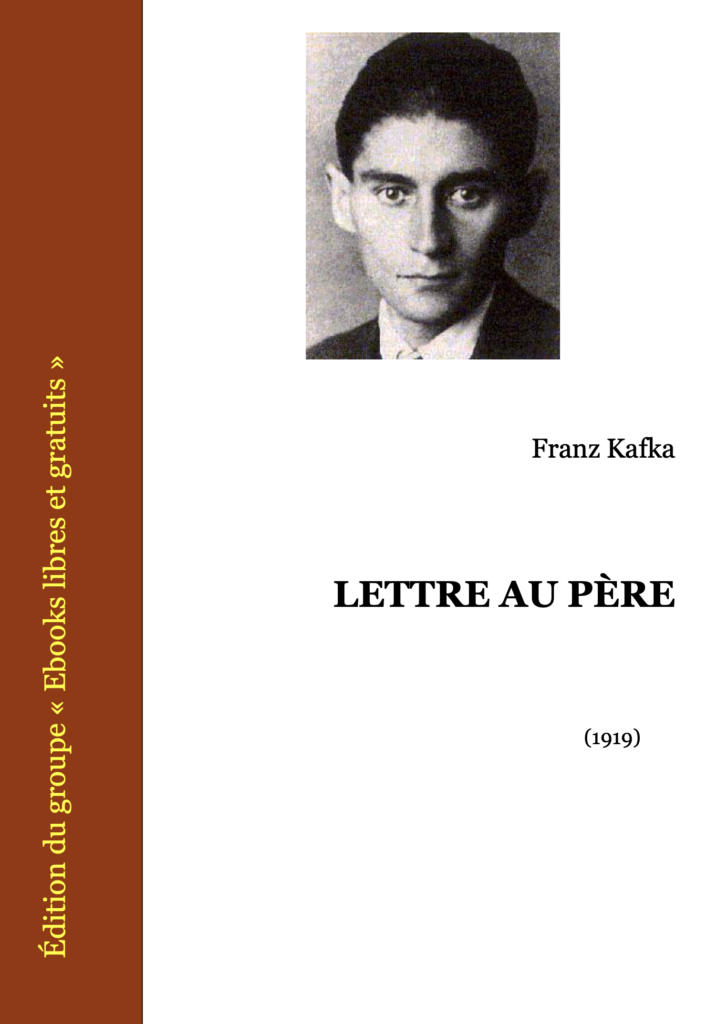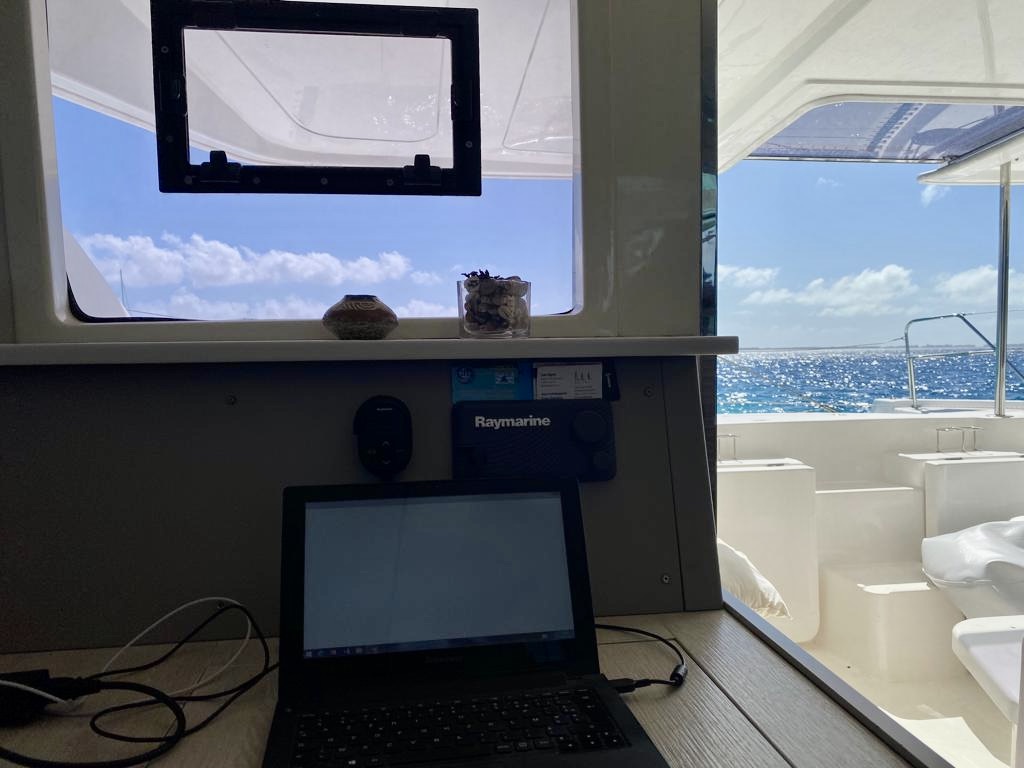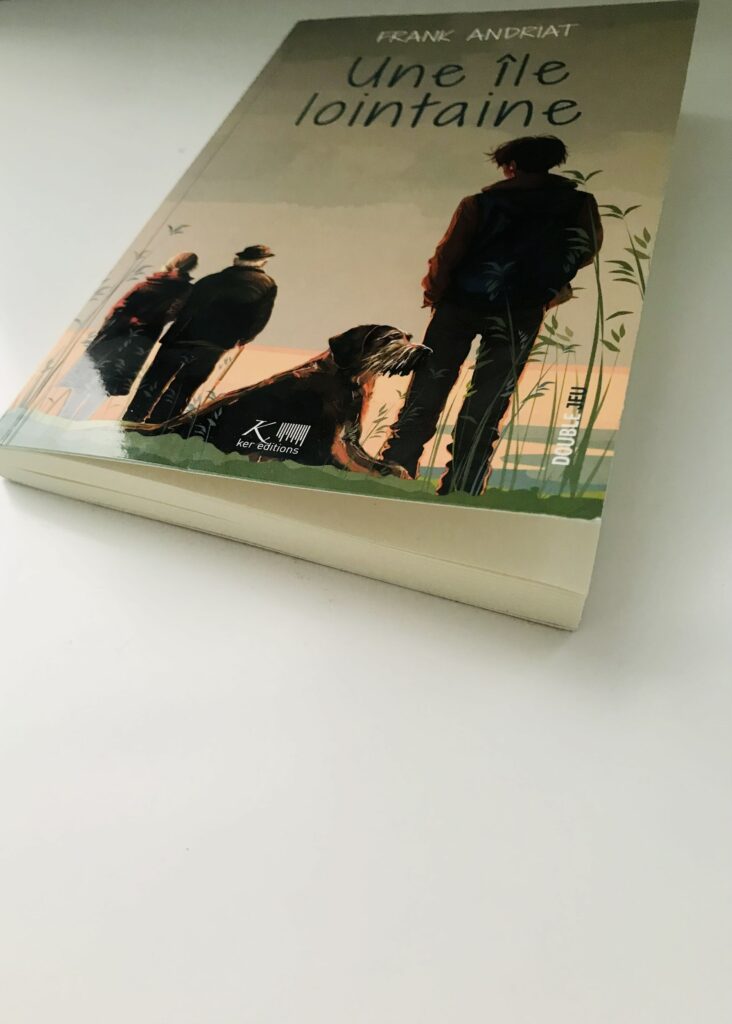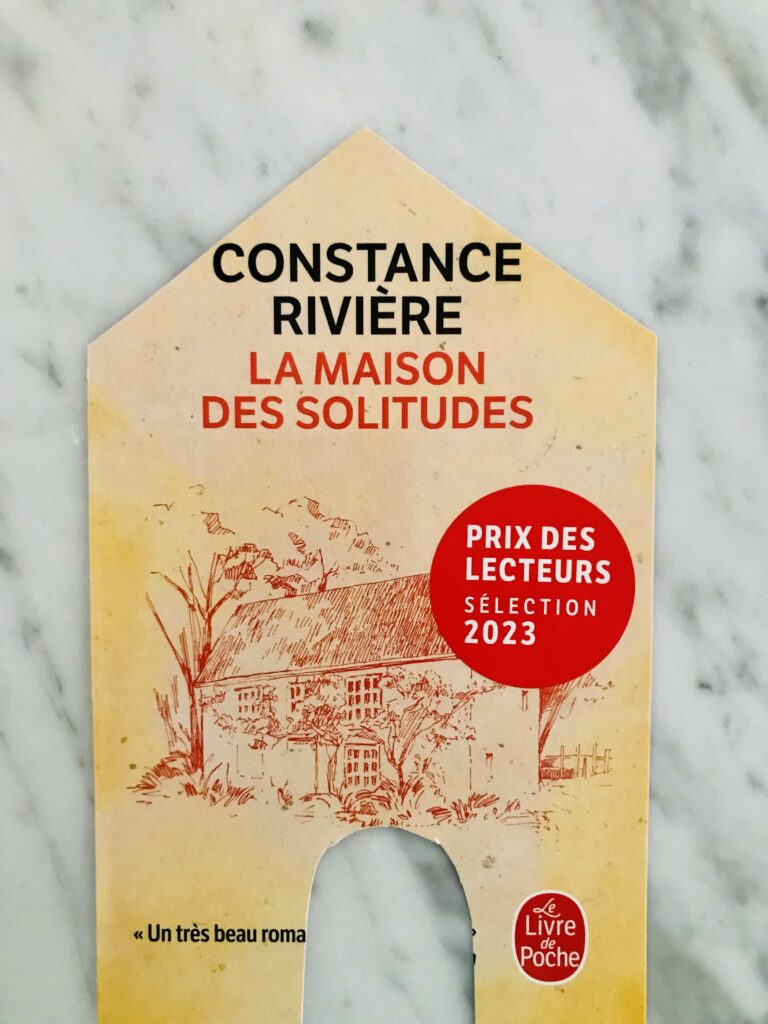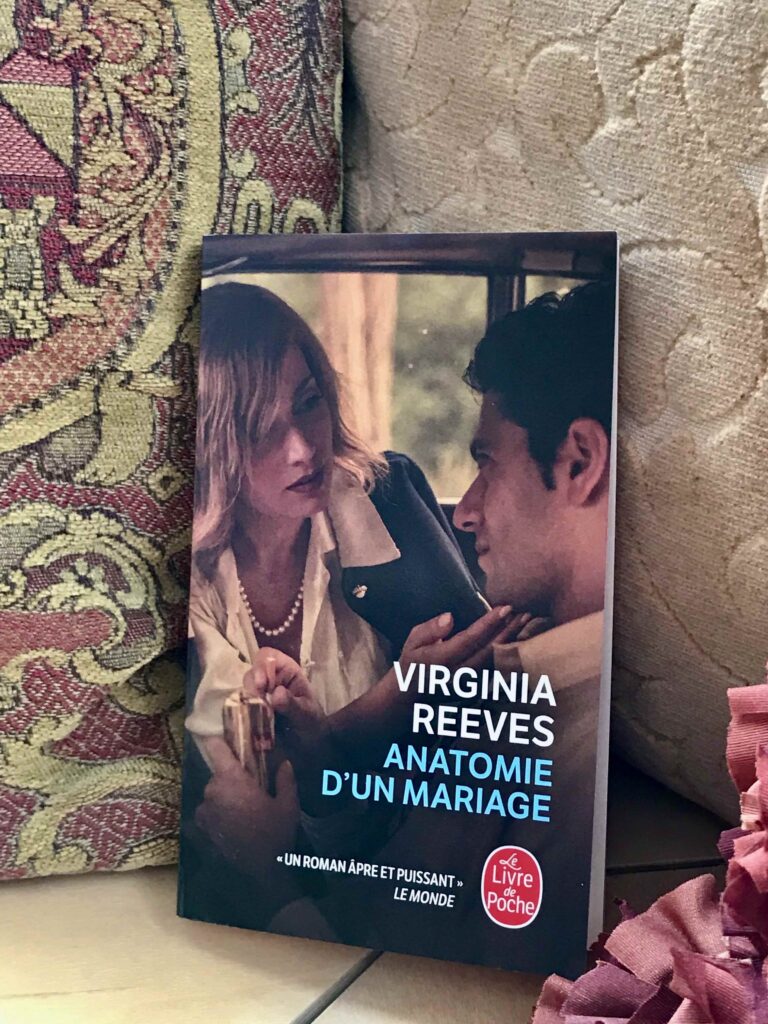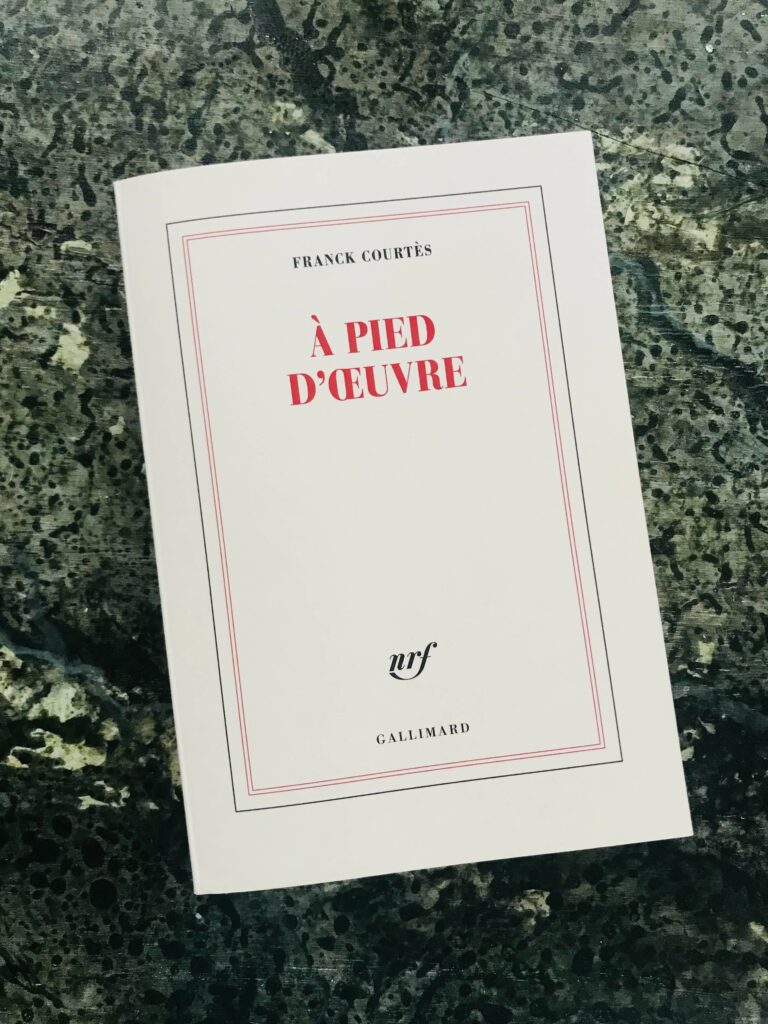
Franck Courtès découvre une lapalissade : Écrire des livres ne fait pas vivre son homme. Bien sûr, il y a toujours quelques exceptions qui confirment la règle, elles ont pour nom Dicker, Grimaldi, Tesson, Bussi, Musso, da Costa et une trentaine d’autres. Tout le reste, comme disait ma mère, c’est de la petite bière.
Franck, donc, que j’ai bien connu (nous avons fait ensemble la rentrée littéraire Lattès en 2014, lui avec Toute ressemblance avec le père et moi avec On ne voyait que le bonheur) nous revient avec un livre* où il raconte qu’il a mis fin à sa carrière lucrative de photographe portraitiste de célébrités (la faute au numérique qui ne lui donnait pas de plaisir) pour s’ébrouer dans celle d’écrivain.
Il publia donc en 2013 un premier recueil de nouvelles qui connut un indéniable succès avec 5000 exemplaires vendus et obtint même un Prix SGDL. Soudain, ça y était, sa route était toute tracée : il allait vivre de son art, sa plume, ses mots. Patatras. La réalité reprit très vite le dessus, ses livres suivants ne marchèrent pas malgré quatre passages à « La Grande librairie » chez son ami Busnel, malgré d’élogieux papiers ici et là ; comme nous tous, il découvrit la brutalité de l’économie du monde des livres.
À environ deux euros bruts par livre, combien doit-on en vendre pour s’offrir un bon gueuleton avec un pote dans un resto parisien ? Et je ne parle même pas d’un loyer**.
À pied d’œuvre est le récit de sa vie de travailleur au noir pour survivre et garder du temps pour écrire. On apprend qu’il apprend à démonter une mezzanine, monter une étagère, descendre des sacs de gravats, débroussailler un balcon, nettoyer des vitres, transporter des meubles, bref un catalogue des petits boulots utiles en temps de disette, jusqu’à cette cliente en « débardeur de toile fine » qui l’émoustille : « Cela enfle malgré moi, comme la levure dans le pain » (page 132).
Ma petite frustration vient de que Franck n’a utilisé aucun de ses outils d’écrivain pour écrire le travail— il a juste fabriqué 184 pages avec la liste de ses petits boulots pour nous convaincre qu’il est un homme à tout faire —, car, lorsque le travail nourrit la littérature et vice versa, cela peut confiner au sublime, ainsi À la ligne*** de Joseph Ponthus que je vous recommande, pour le coup, absolument.
*À pied d’œuvre, de Franck Courtès. Chez Gallimard. En librairie depuis le 24 août 2023.
**Franck nous apprend dans son livre qu’il jouit gracieusement d’un petit appartement familial.
***À la ligne, feuillets d’usine, de Joseph Ponthus. Éditions de La Table Ronde. En librairie depuis le 3 janvier 2019.