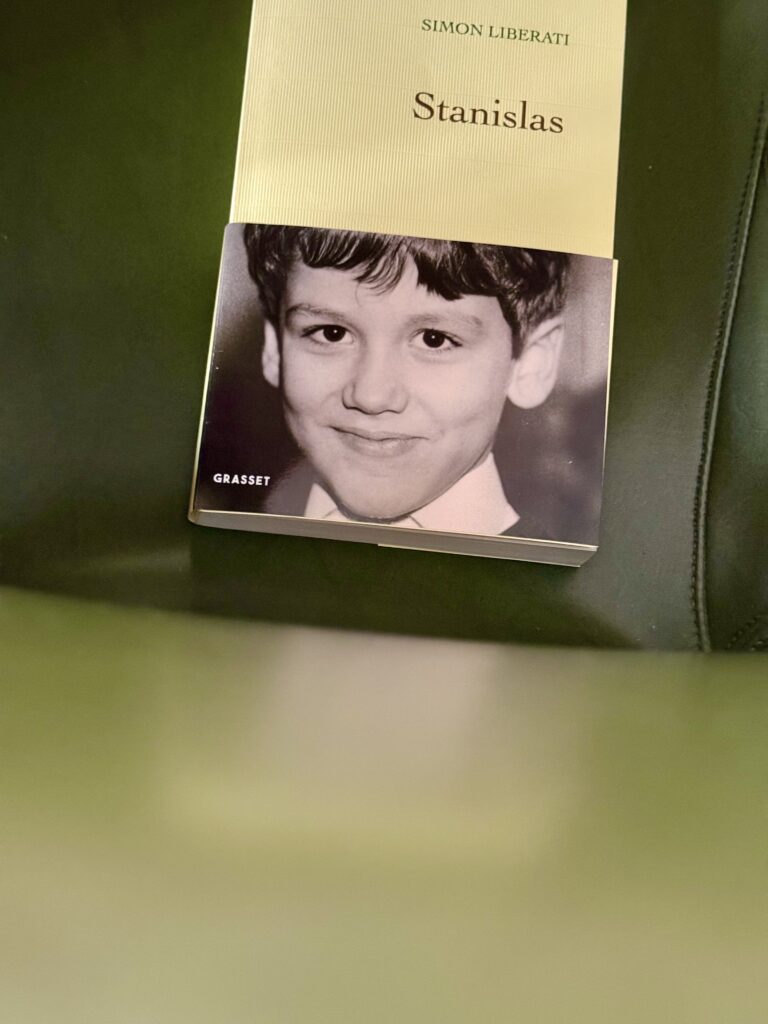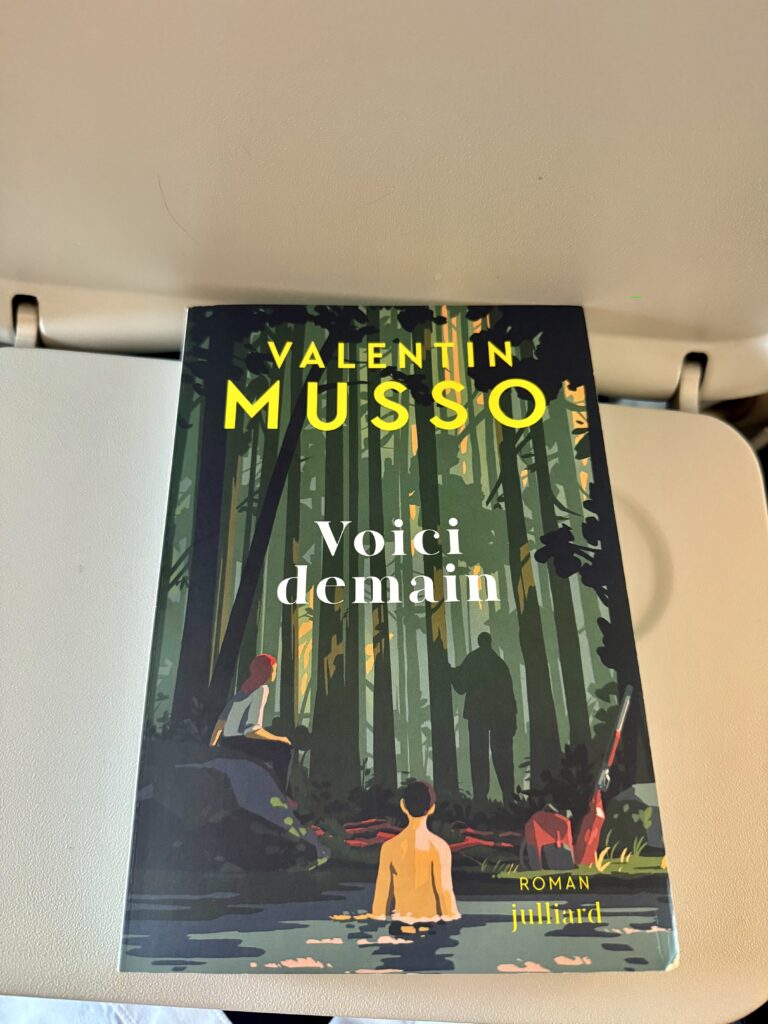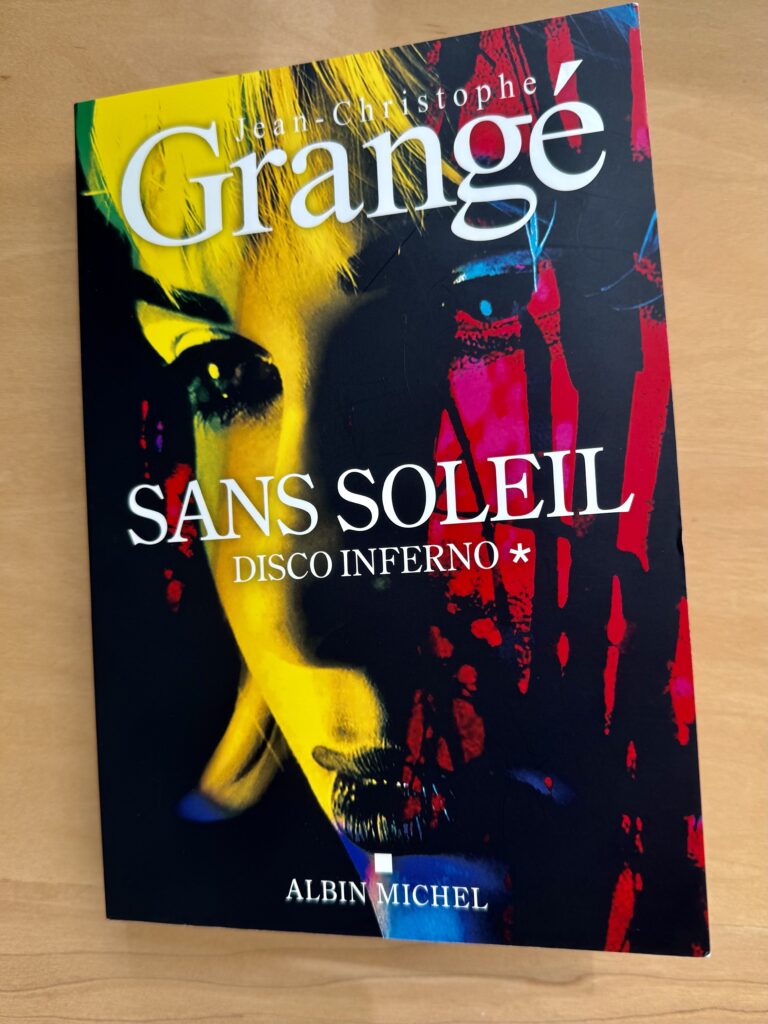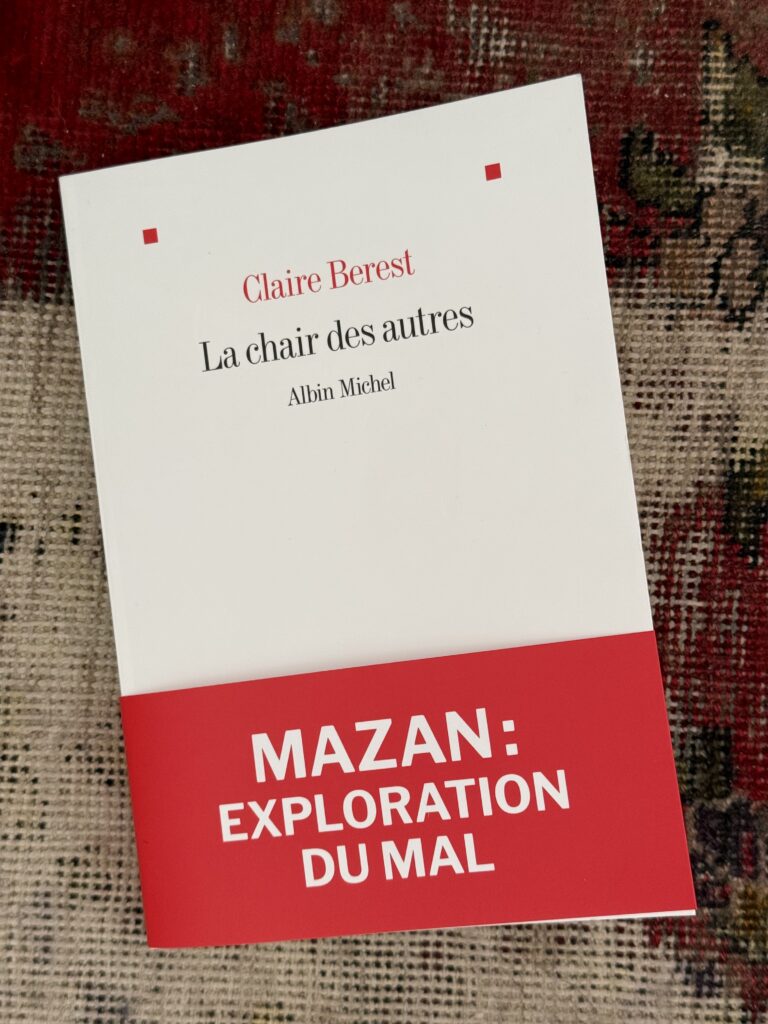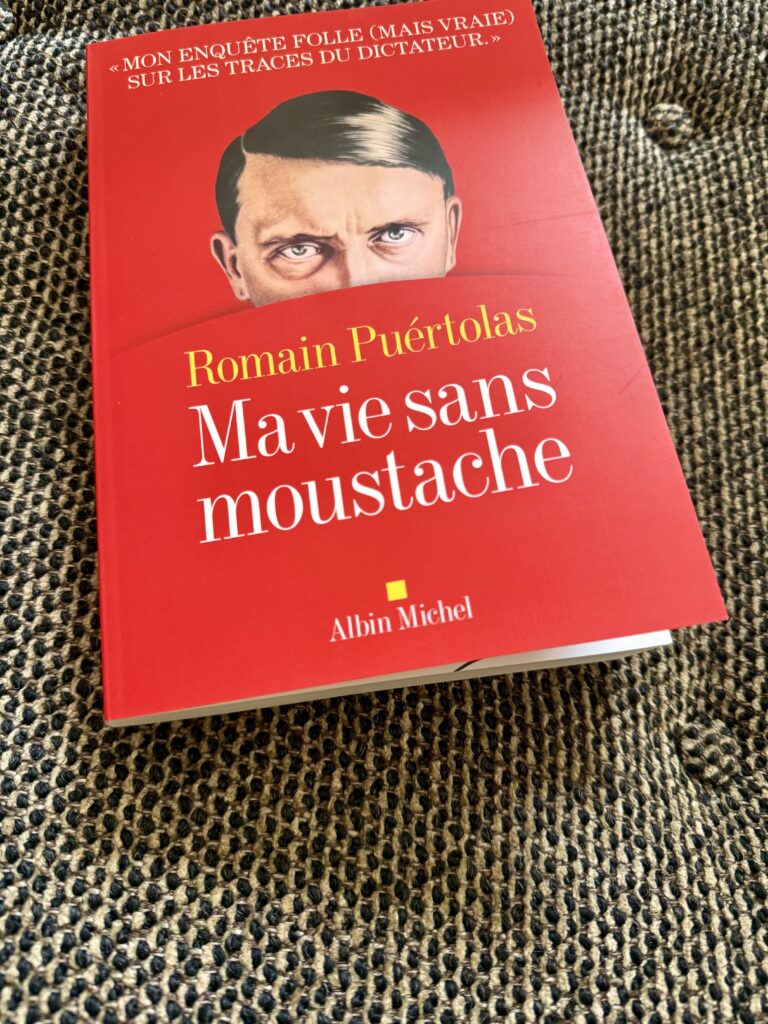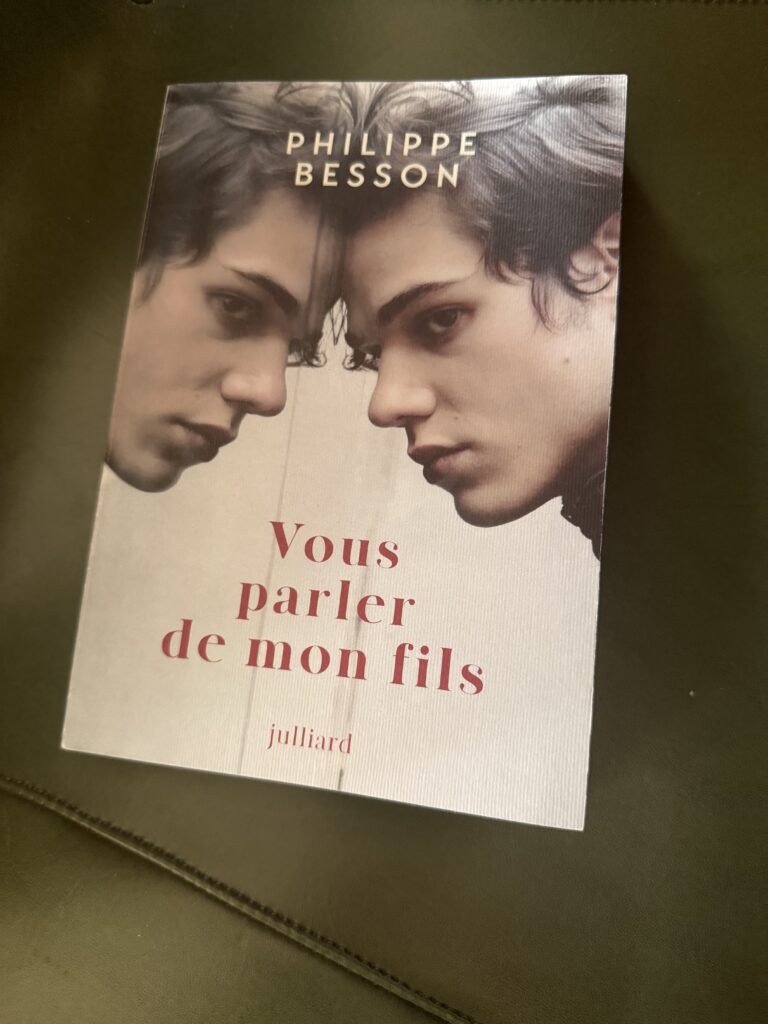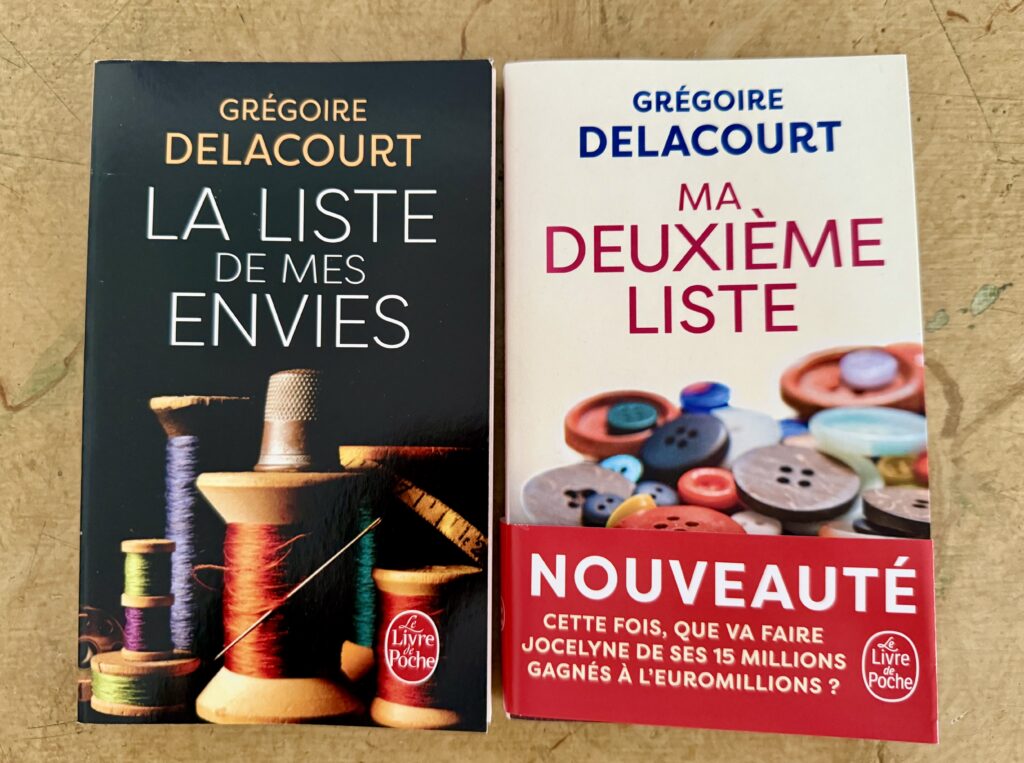Superhôte, c’est la note maximale qu’un loueur d’Airbnb peut espérer obtenir, mais c’est aussi le titre de ce nouveau roman* d’Amélie qui nous entraine dans une location de courte durée au Touquet en suivant la vie d’une femme de l’ombre : la femme de ménage. Ramasseuse de merde. Nettoyeuse de vomi. Aspiratrice de poussières et autres mochetés. Rangeuse de tout. Flingueuse d’araignées, mites et tiques. Femme qu’on siffle au dernier moment pour rendre à l’appartement tout son lustre et qui voit défiler toutes sortes de gus, jusqu’au jour où l’un d’entre eux, par ricochet, déclenche l’irréparable.
Superhôte est formidablement jouissif, démarre sur les chapeaux de roues, style alerte, esprit, humour, cynisme, et soudain bascule dans le drame, l’émotion, la noirceur, l’immense bêtise des hommes.
Et ça, ça vaut bien une supernote.
*Superhôte, d’Amélie Cordonnier, aux éditions Flammarion. En librairie depuis le 26 mars 2025.