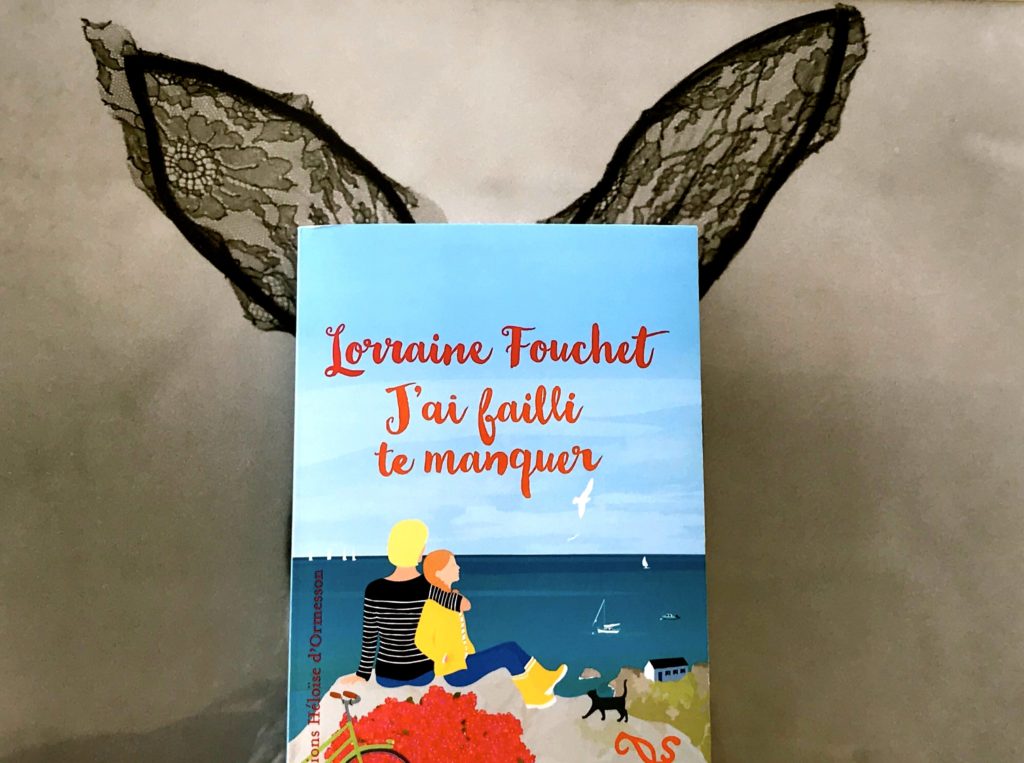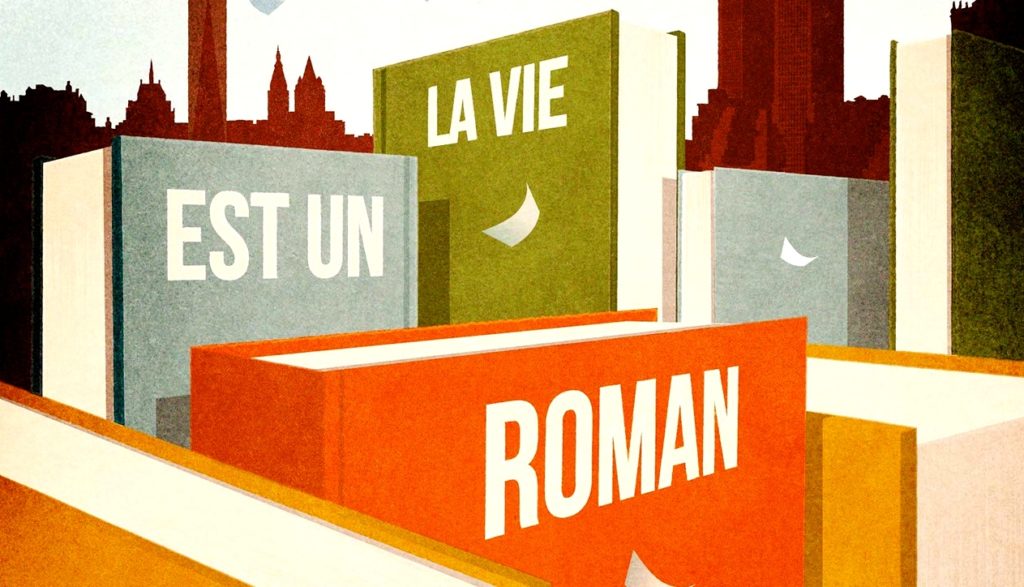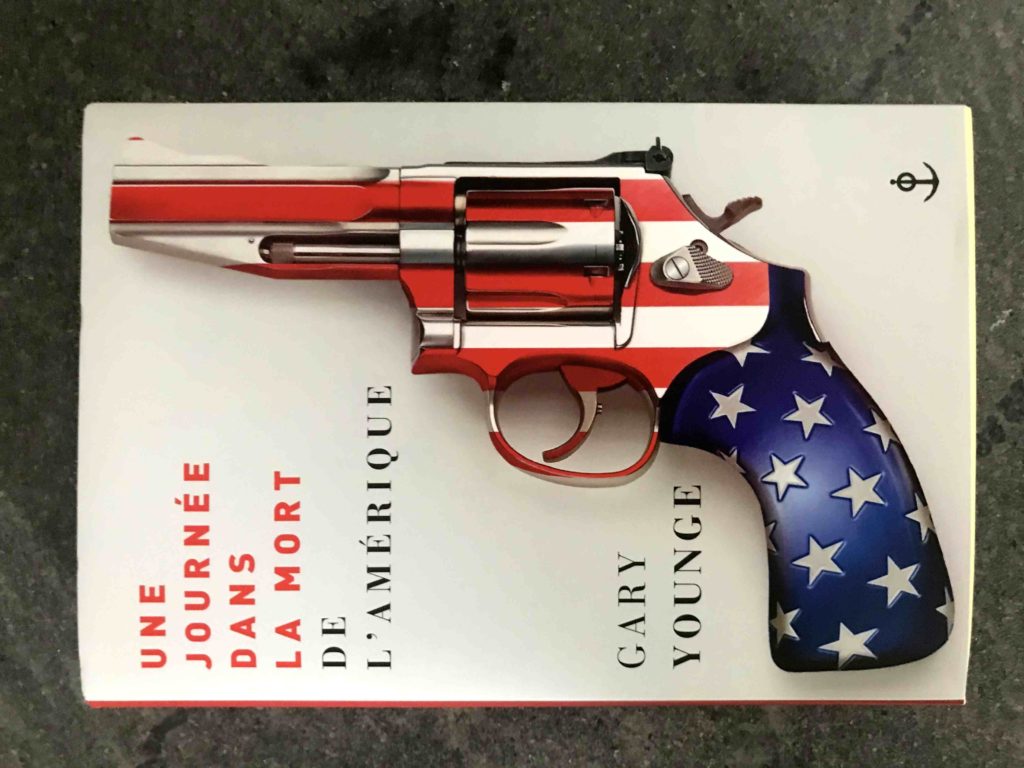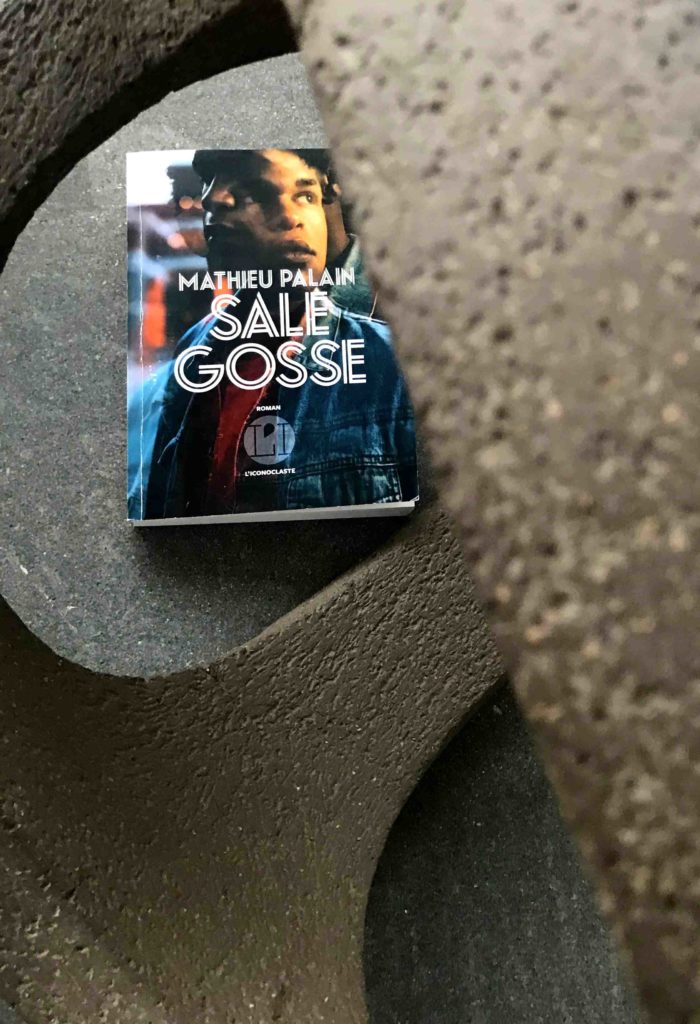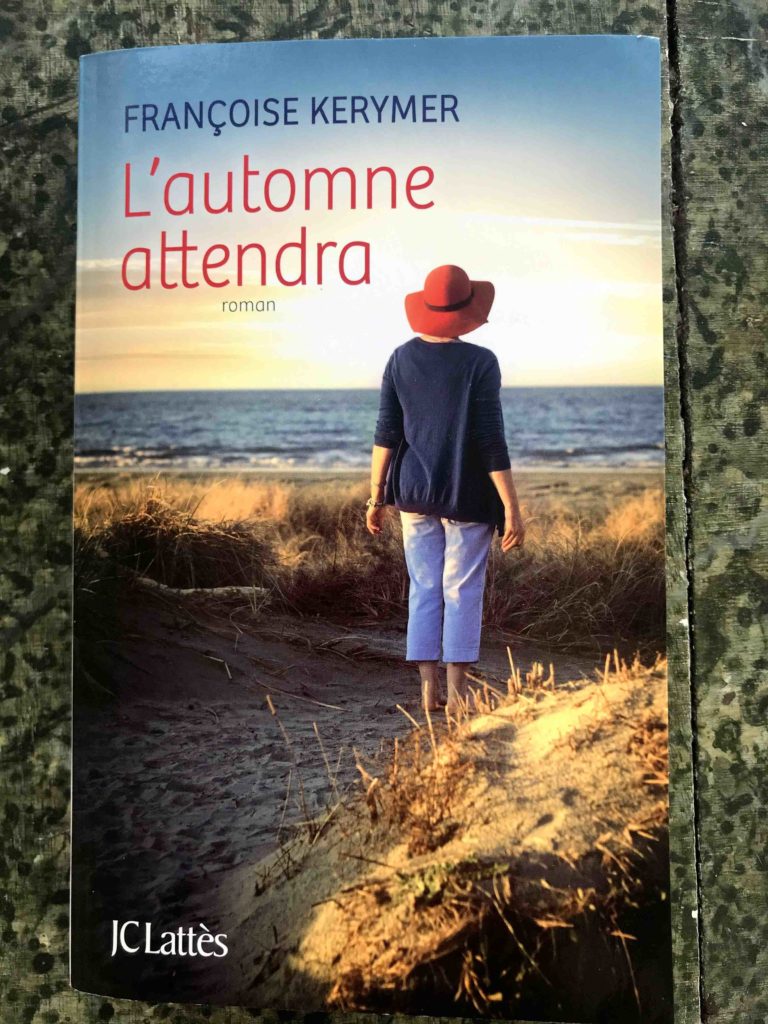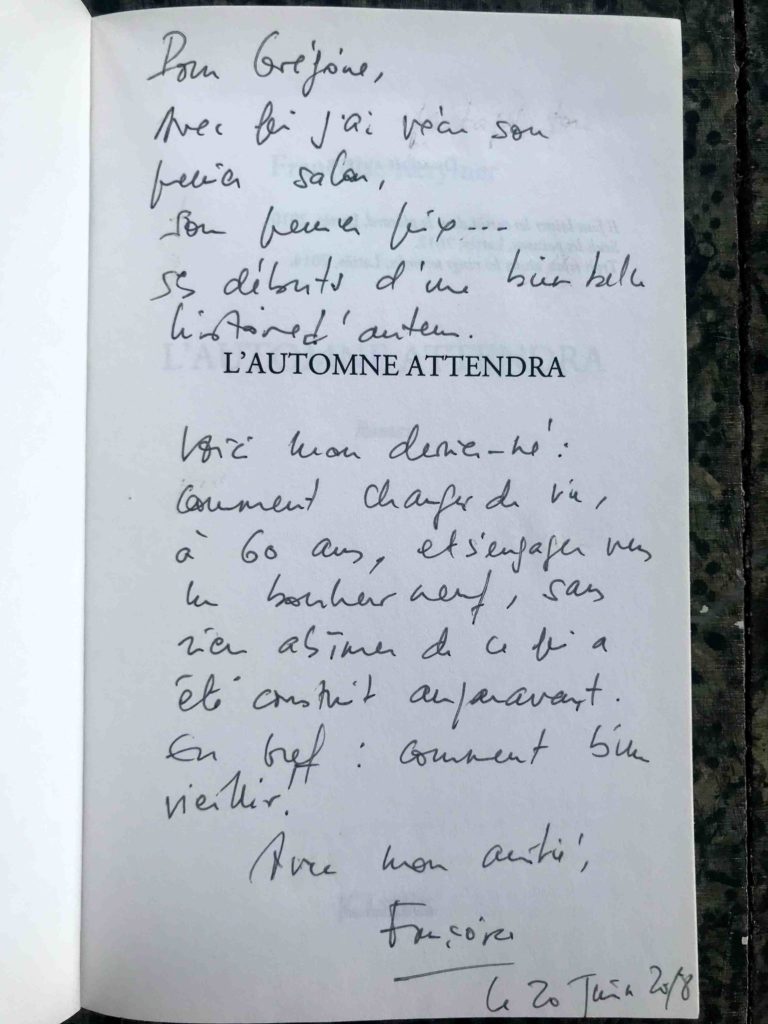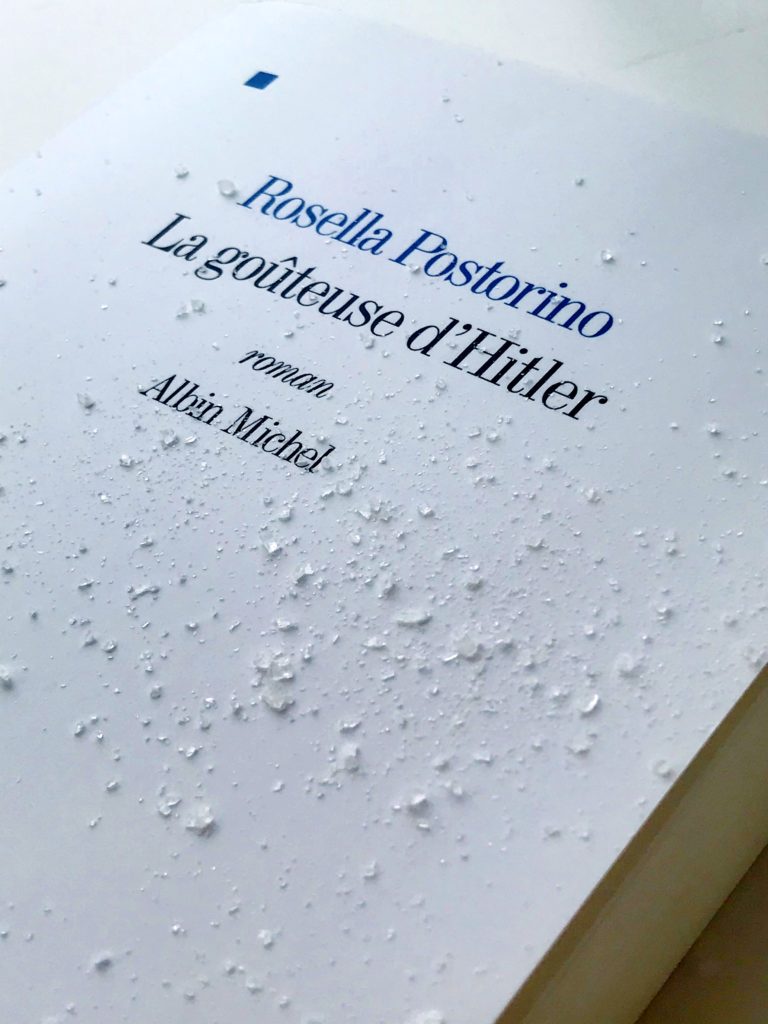Lire au temps du virus. Lire un autre temps, un autre mal, celui du temps où ce n’étaient pas les chefs qui péroraient qui gagnaient les guerres, mais les troupes, les hommes et les femmes de l’ombre. En ce temps bavard où chacun a sa vérité sur ce qui nous décime, ramenons l’immense René Char au centre et écoutons-le.
Les Feuillets d’Hypnos*, ce sont 235 notes écrites entre 1943 et 1944 alors que René Char était engagé dans la Résistance sous le nom de Capitaine Alexandre – on peut d’ailleurs penser, à la lecture de la note 87 (adressée à Léon Saingermain et qui fixe quelques protocoles) signée Hypnos qu’il ait aussi pu emprunter ce nom, du grec Húpnos, dieu du sommeil, mais aussi jumeau de Thanatos, et père de Morphée, dieu des rêves. Car René Char, dans une écriture libérée de tout – ah ce “Guérir le pain. Attabler le vin” (note 184) –, nous offre ses réflexions poétiques en temps de guerre, donc de mort, ce grand chambardement d’un homme, inutile et nécessaire, et n’a de cesse que de nous réveiller de nos torpeurs craintives, de nous pousser dans l’abîme de la vie, comme au coeur d’un feu dont nous serions les cendres éternelles. La guerre, finalement, est le seul temps dont on dispose pour se refaire une humanité. Comme on se refait le portrait. Alors, lire Char aujourd’hui, c’est bien mieux et plus salutaire qu’écouter notre chefaillon de guerre. Voici sa note 195:
“Si j’en réchappe, je sais que je devrai rompre avec l’arôme de ces années essentielles, rejeter (non refouler) silencieusement loin de moi mon trésor, me conduire jusqu’au principe du comportement le plus indigent comme au temps où je me cherchais sans jamais accéder à la prouesse, dans une insatisfaction nue, une connaissance à peine entrevue et une humilité questionneuse.”
*Feuillets d’Hypnos, de René Char. Éditons Gallimard (1946), coll Espoir, dirigée par Albert Camus.
Un immense merci à Michel Persitz pour m’avoir offert ce livre rare.
PS. Désolé pour l’effroyable jeu de mots du titre de cet article. Mais je voulais vous interpeller sur la nécessité de ramener Char dans nos lectures.