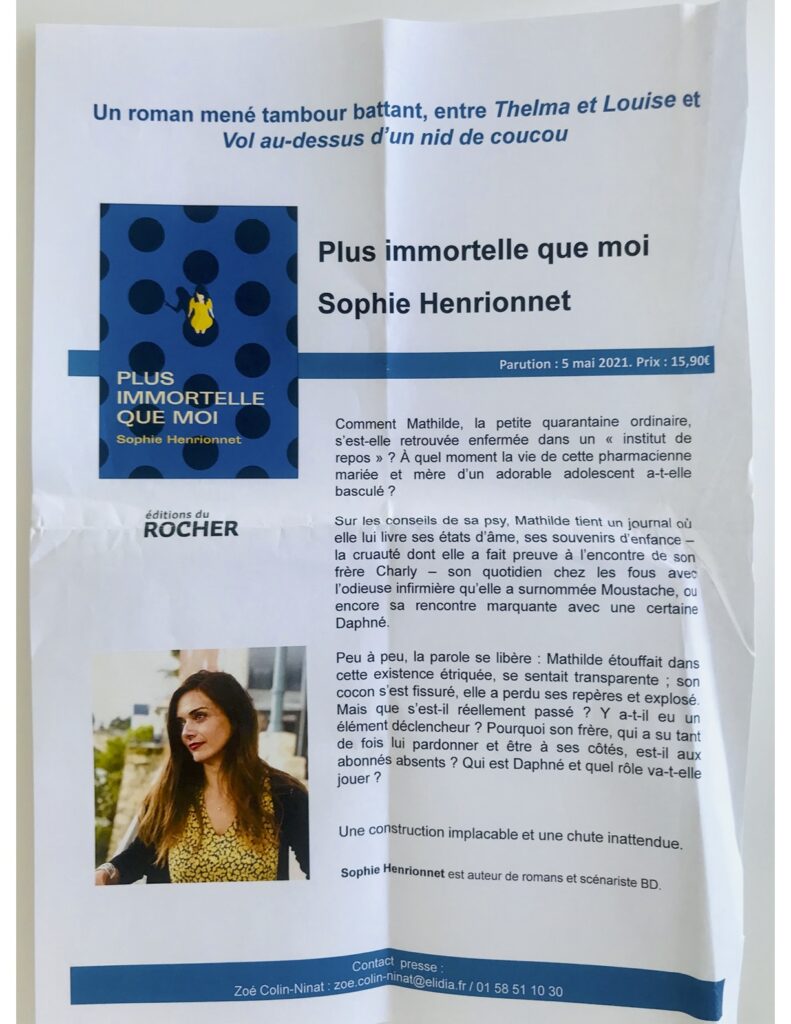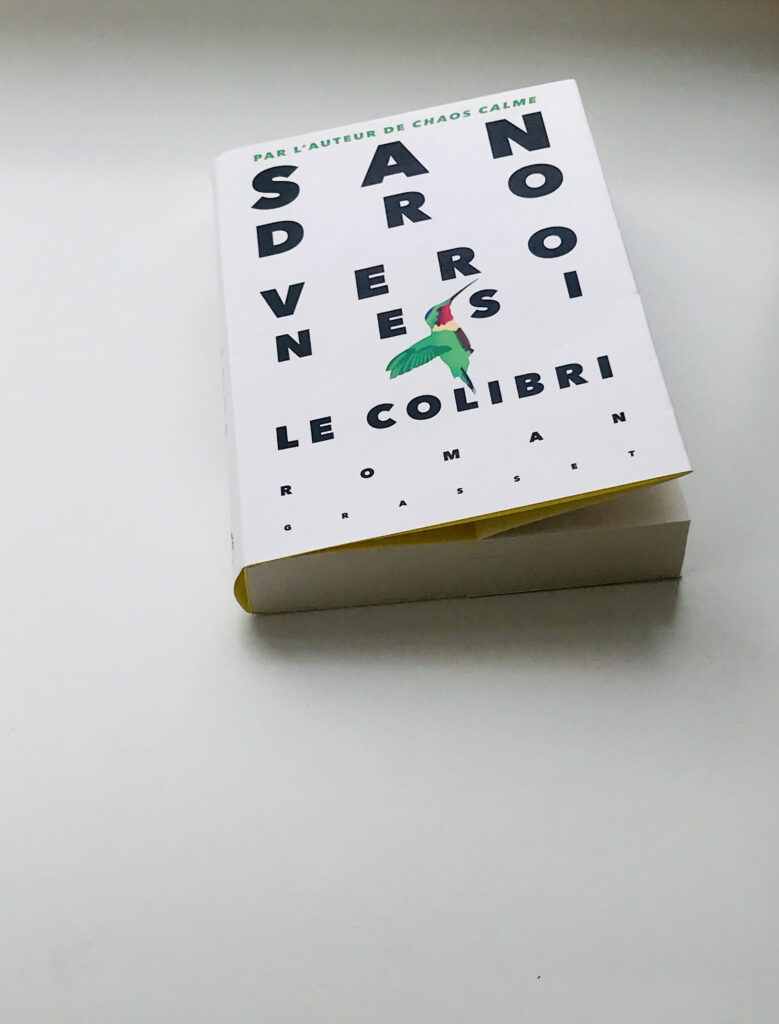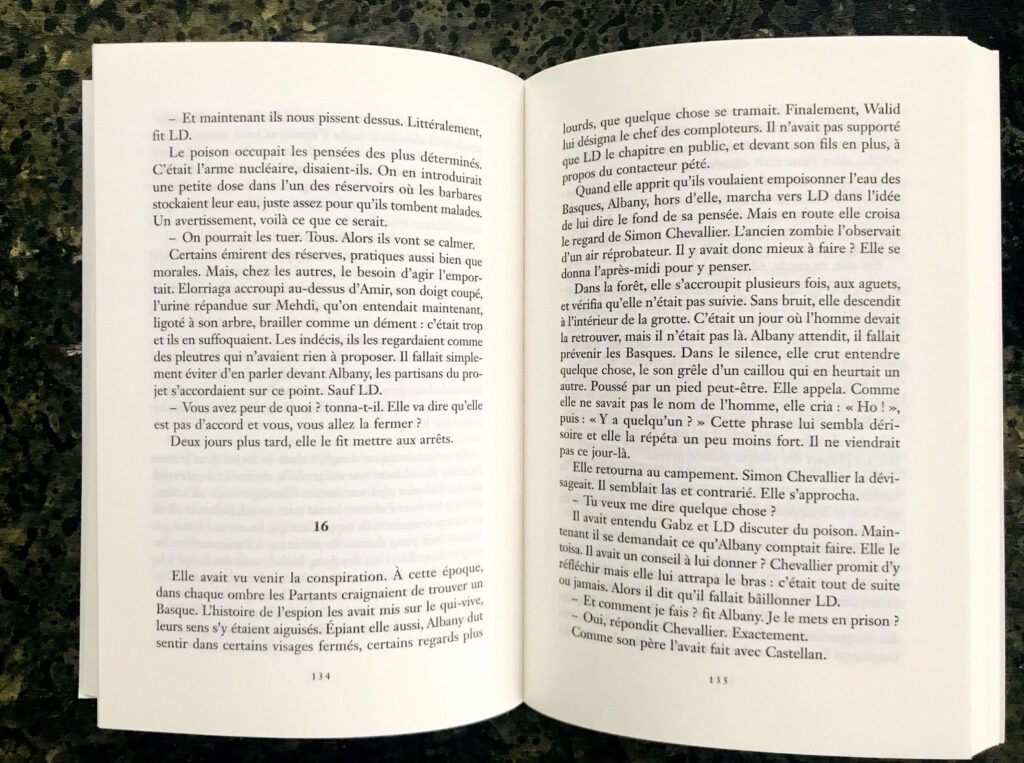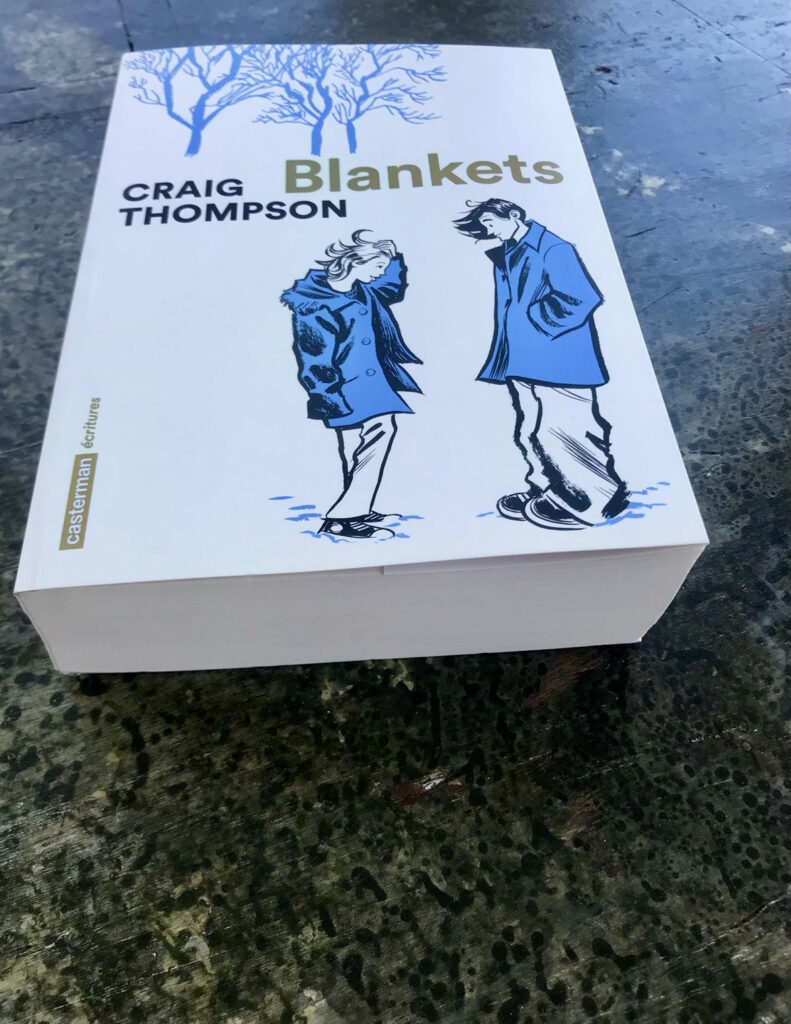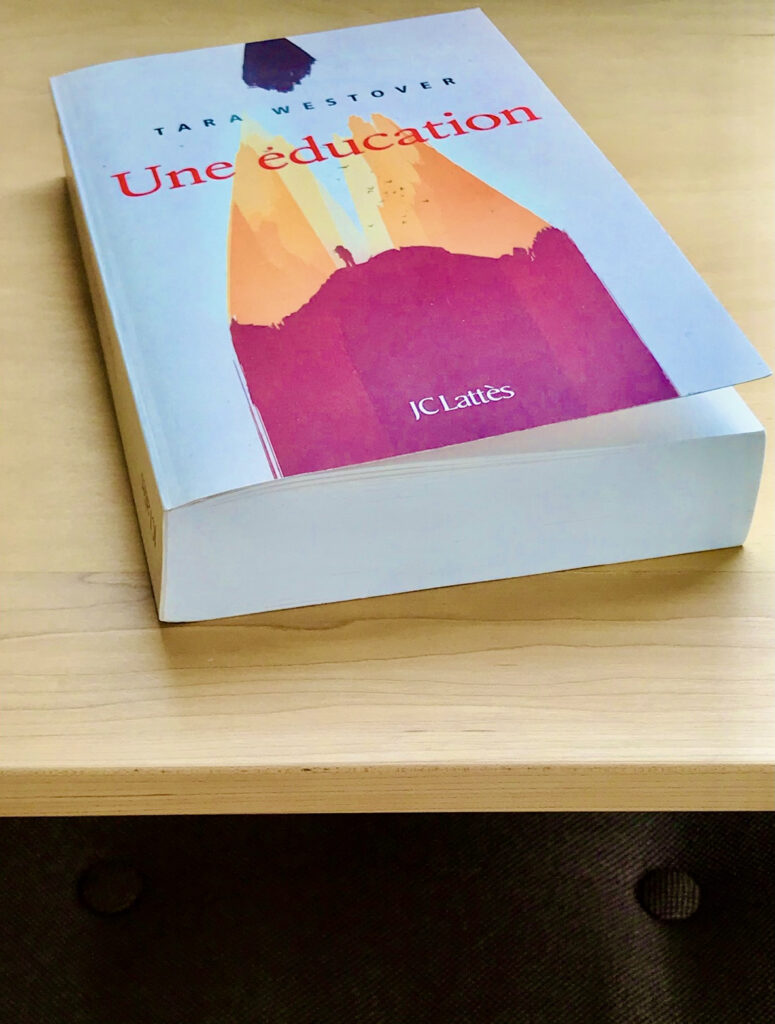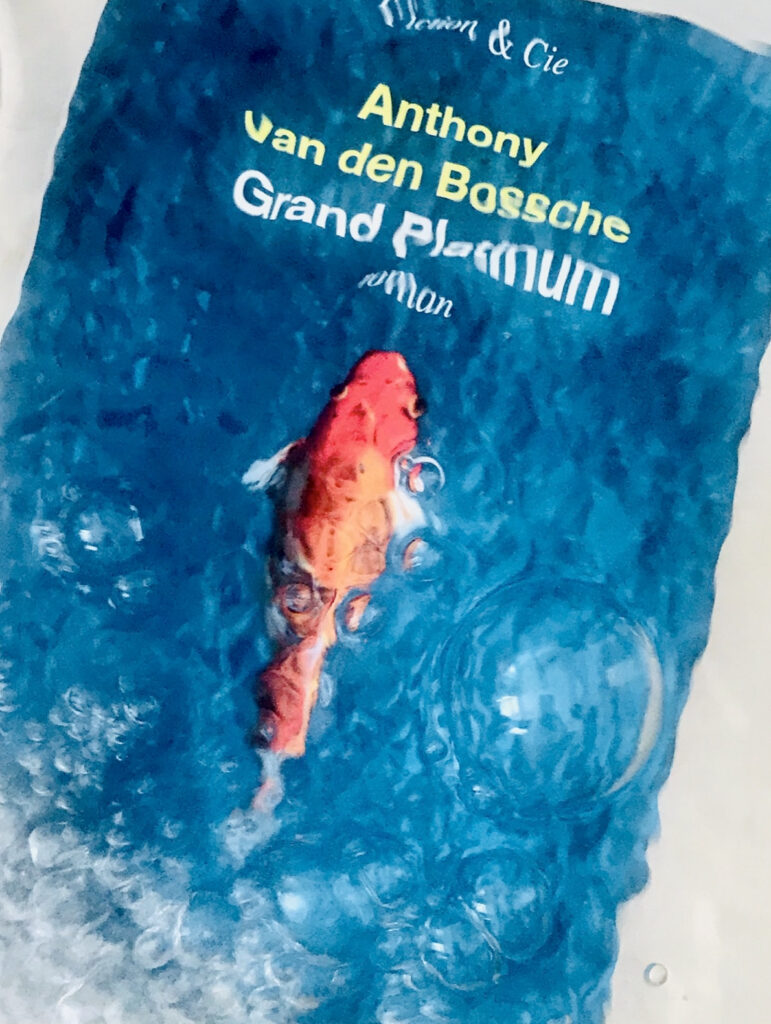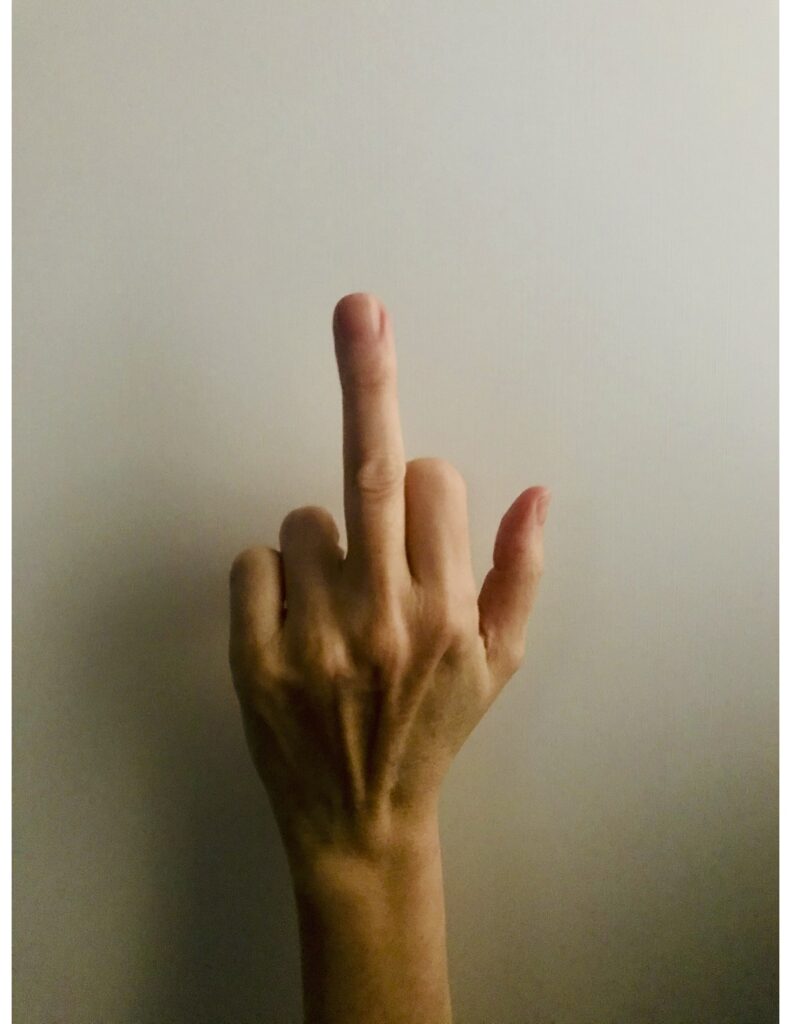Sur la route de Madison. Madame Butterfly. Ethan Frome. La Lettre écarlate… On rêve à chaque fois que les amants trouvent leur île et puis non, c’est un mirage. Un naufrage. C’est à cette famille terrible des amours impossible qu’appartient la très belle nouvelle pièce de théâtre* de Carine Marret qui met en scène Napoléon et Joséphine.
Dans leurs correspondances, le premier écrivait : « J’ai perdu l’espérance d’avoir des enfants de mon mariage avec ma bien-aimée épouse l’Impératrice Joséphine ; c’est ce qui me porte à sacrifier les plus douces affections de mon cœur, à n’écouter que le bien de l’État, et à vouloir la dissolution de notre mariage », à quoi l’amoureuse avait répondu : « La dissolution de mon mariage ne changera rien aux sentiments de mon cœur : l’empereur aura toujours en moi sa meilleure amie. Je sais combien cet acte commandé par la politique et par de si grands intérêts a froissé son cœur ; mais l’un et l’autre nous sommes glorieux du sacrifice que nous faisons au bien de la patrie ». Et voilà que Carine nous raconte en deux actes virtuoses l’apogée et la chute de leur furiosité amoureuse ; le premier, le 29 novembre 1804, trois jours avant le Sacre, le second, le 30 novembre 1809, quinze jours avant leur divorce. Napoléon et Joséphine, un amour impérial est le huis-clos de l’intime et de la passion, un fascinant ping-pong amoureux où la raison d’État va finir par l’emporter sur celle de l’adoration. C’est tragique. C’est magnifique. C’est à lire en attendant d’être vu sur scène et s’il vous plaît, si vous connaissez un bon metteur en scène, offrez-lui le texte sans tarder.
* Napoléon et Joséphine, un amour impérial, théâtre, de Carine Marret, aux Éditions du Cerf. En librairie depuis mais 2021.