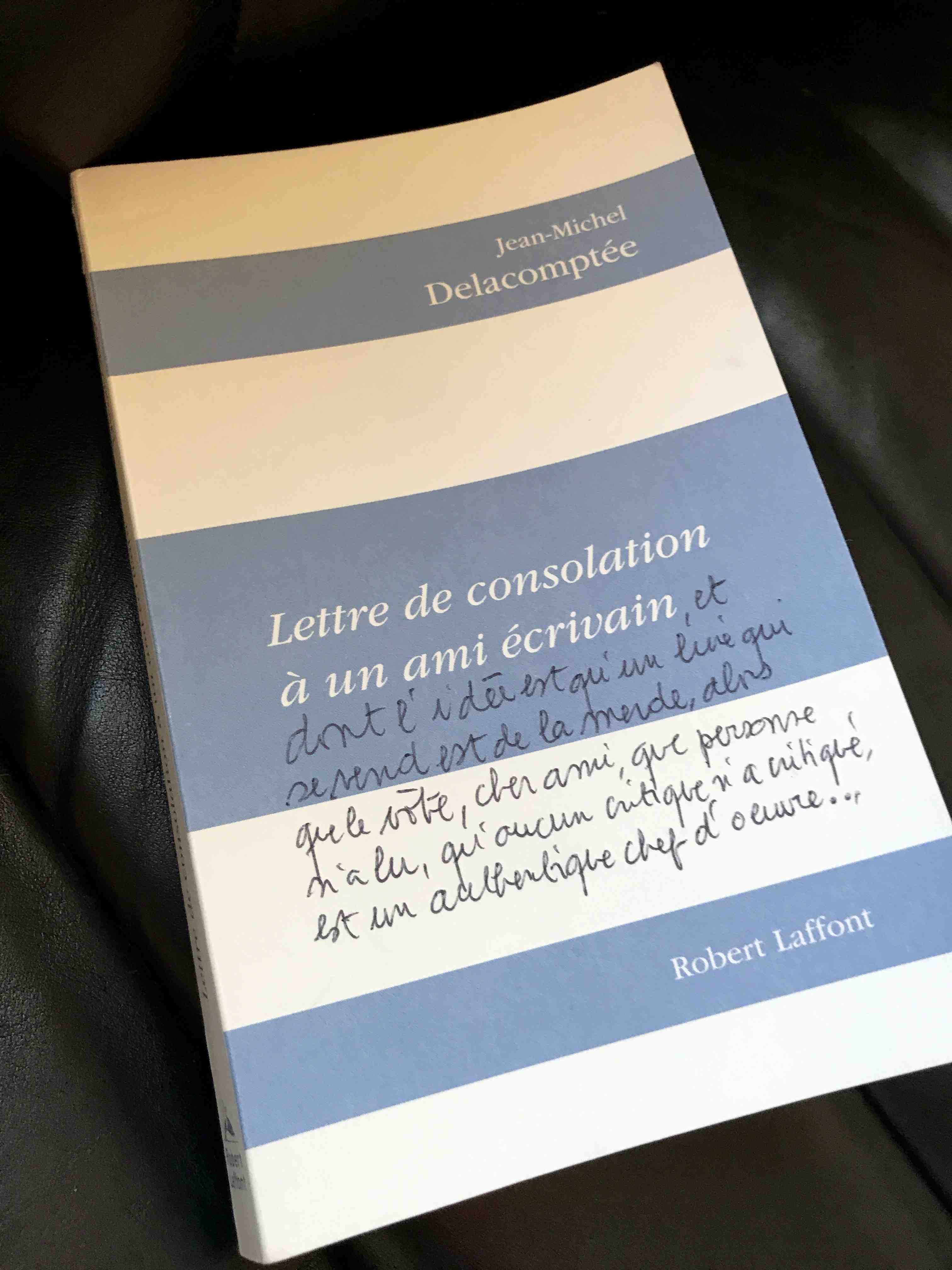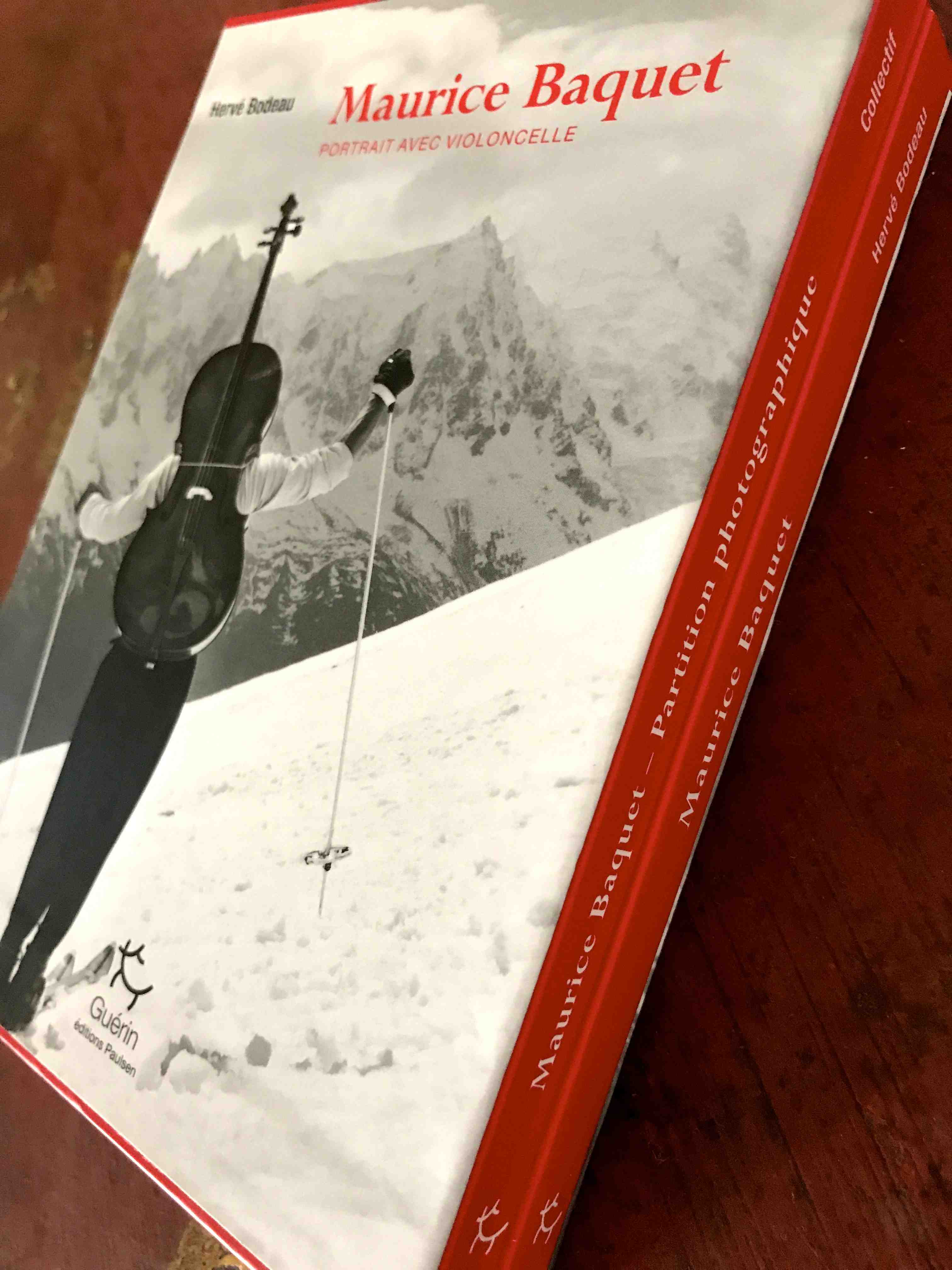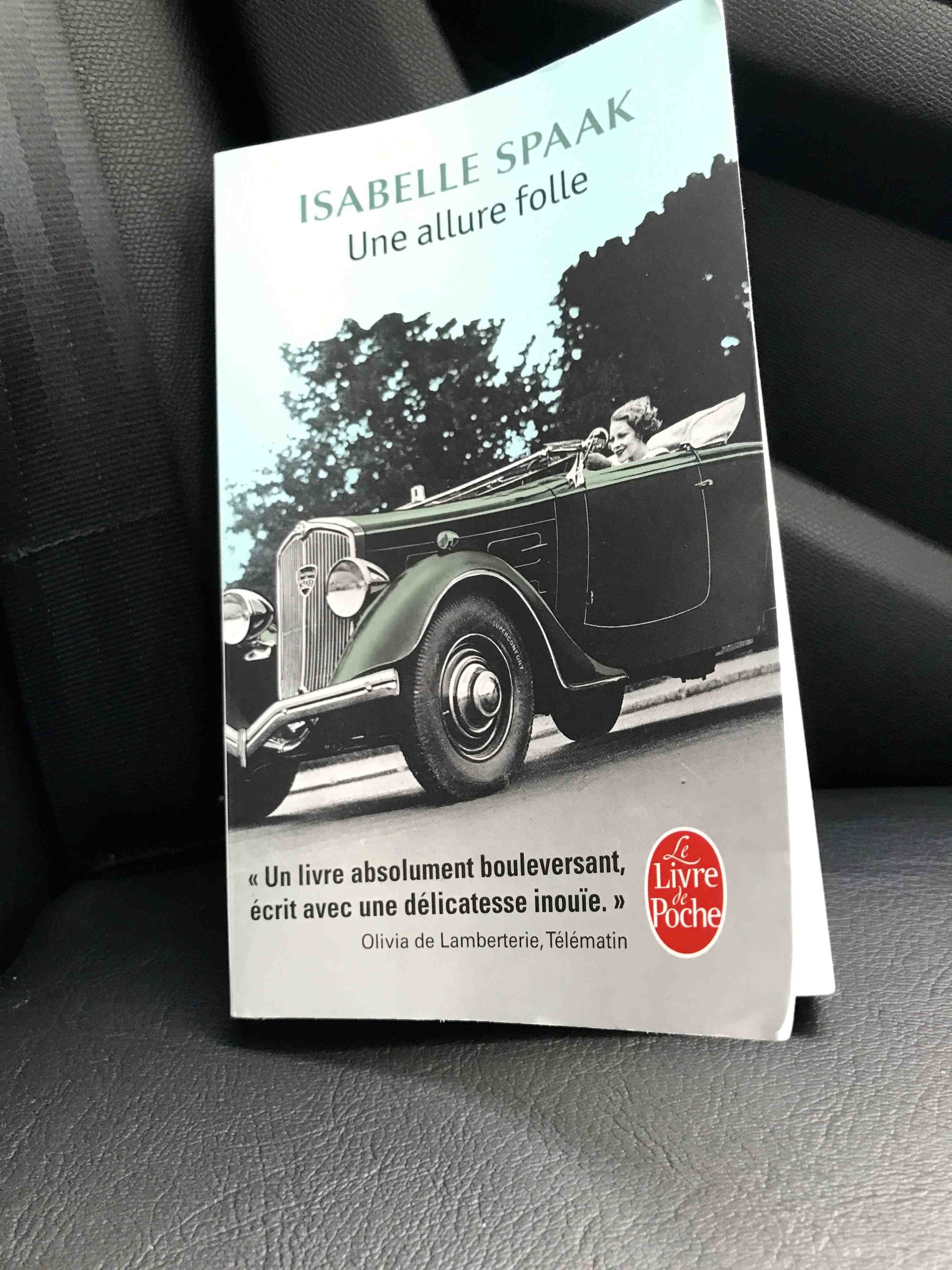Ce qu’il y a d’assez épatant avec certains livres d’anticipation, c’est que tôt ou tard, ils deviennent dépassés. Prenons 1984. Un futur glaçant dont on se moquait en pensant que c’était impossible, ridicule même. Et voilà. 1984, nous y sommes. Big Brother s’appelle Facebook, Apple, Twitter, Google. Nous sommes sans cesse surveillés, espionnées, traquées. Même le centre commercial « Les Quatre Temps » à La Défense y va de son espionnite. Mais nous restons heureux, hypnotisés, fascinés que nous sommes de pouvoir échanger gratuitement nos photos de bouffe en tous lieux, écouter de la musique gratuite où l’on veut, voir gratuitement des films où que l’on soit –méfiance. Tim Cook, président d’Apple, a dit un jour : Quand c’est gratuit c’est que c’est vous le produit. Et il nous le démontre chaque jour, ah, ah. Pour l’anecdote, je me rappelle avoir moi-même écrit un film important pour Apple en 1989, qui dénonçait la toute puissance du pouvoir de la pensée et je crois, malheureusement, qu’Apple est devenu ce qu’il combattait alors.
Voici donc le retour d’un grand texte dystopique d’anticipation, La Servante écarlate*, paru pour la première fois en 1985, qui met en scène un monde (américain) où des fanatiques religieux ont pris le pouvoir, et dans lequel les femmes sont à nouveau infra-humaines (sauf celles de la caste supérieure**, bien sûr). L’histoire est racontée par Defred, une de ces servantes, destinées à la reproduction, mais surtout par celle qu’elle était avant, au temps des souvenirs heureux, au temps de la liberté, des livres et de l’amour. Depuis l’élection de Trump, ce livre est devenu un manifeste dans la main des femmes, et Emma Watson en cache même des exemplaires dans tout Paris. Enfin, vient de sortir une série télé*** avec l’excellente Elisabeth Moss (absolument parfaite dans Mad Men) qui montre à quel point la liberté des femmes est encore bien fragile. On ne pourra pas dire cette fois que nous n’étions pas prévenus.
*La Servante écarlate, de Margaret Atwood. Édition Pavillons Poche / Robert Laffont en librairie depuis le 8 juin 2017. (Le titre de cet article est un clin d’oeil à la formidable La Lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne, où une femme est condamnée à porter la lettre A de l’adultère, pour avoir aimé).
** Ce qui fait écrire à Atwood dans sa postface, page 519 : « On a souvent qualifié La Servante écarlate de «dystropie féministe» mais ce terme n’est pas strictement approprié. Dans une dystropie féministe pure et simple, tous les hommes auraient des droits bien plus importants que les femmes. »
***http://culturebox.francetvinfo.fr/series-tv/la-servante-ecarlate-une-serie-derangeante-qui-arrive-en-france-258559