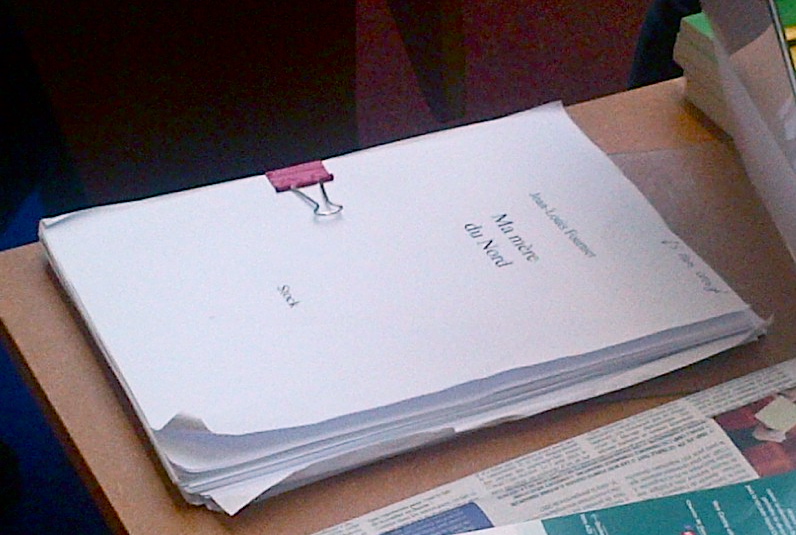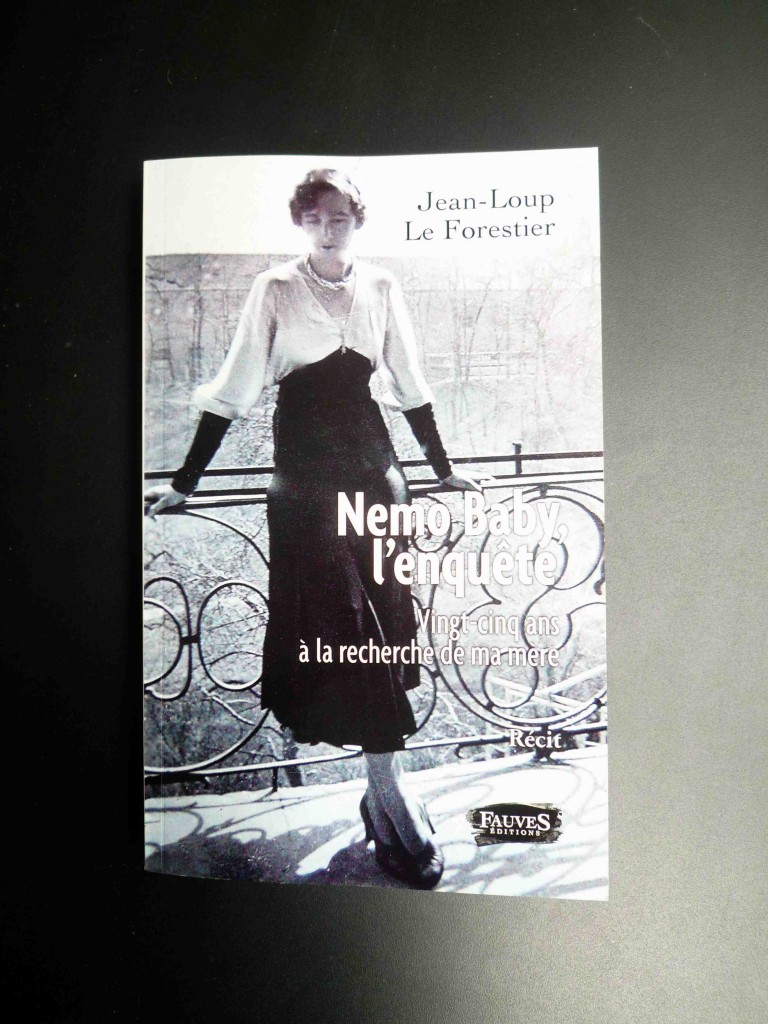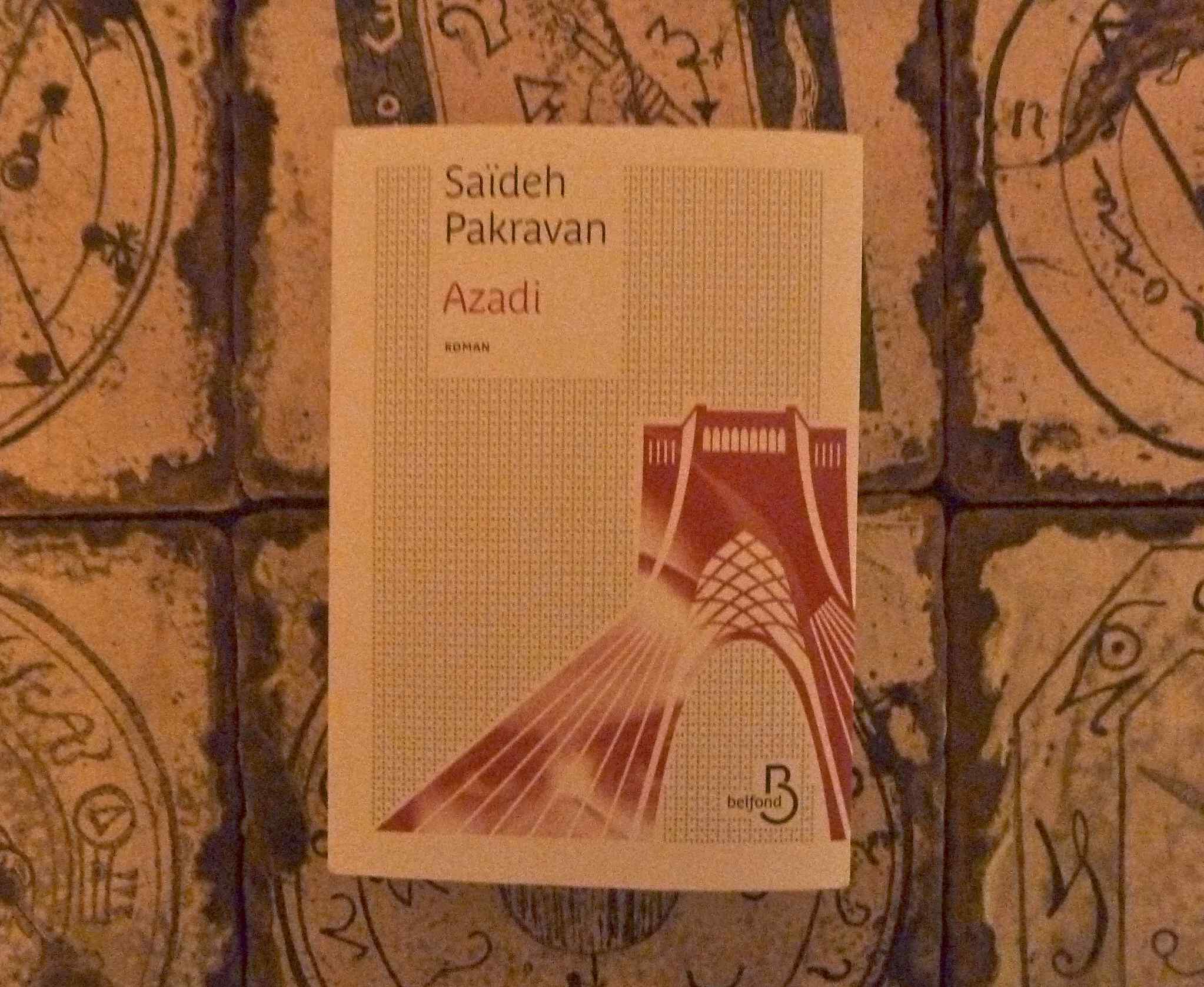Il y a 10 jours, je vous présentais un livre* dont le point de départ était la photo d’une maman qui aurait du être enceinte de huit mois et qui ne l’était absolument pas.
Aujourd’hui, c’est une autre photo qui est à l’origine d’un livre. Le portrait amoureux de Fred et Élise. Pris dans les années 1940. Ils sont beaux – pour l’époque. Ils ont un brushing Elsève Balsam. Ils sont enlacés. Ils regardent l’avenir. Et c’est cet avenir que nous raconte Frank Andriat. Un avenir inventé à partir de la photo, dont le copyright nous apprend qu’elle provient de Super Stock/Getty Images. Inventer une vie, c’est l’essence même du roman ; et Frank, en bon et roué romancier qu’il est, nous invente avec une immense délicatesse des vies sombres, nous dessine dans une ambiance délicieusement simenonienne d’aujourd’hui des âmes douloureuses, des regards pervers, des chagrins étouffés ; à l’opposé de la béatitude idiote des deux promis de la photo.
Mais si, en vrai, ces deux-là avaient été réellement heureux ?
*Nemo Baby, l’enquête, Jean-Loup Le Forestier, Fauves éditions.
**Ces morts qui se tiennent par la taille, Frank Andriat, éditions du Rocher. En librairie.