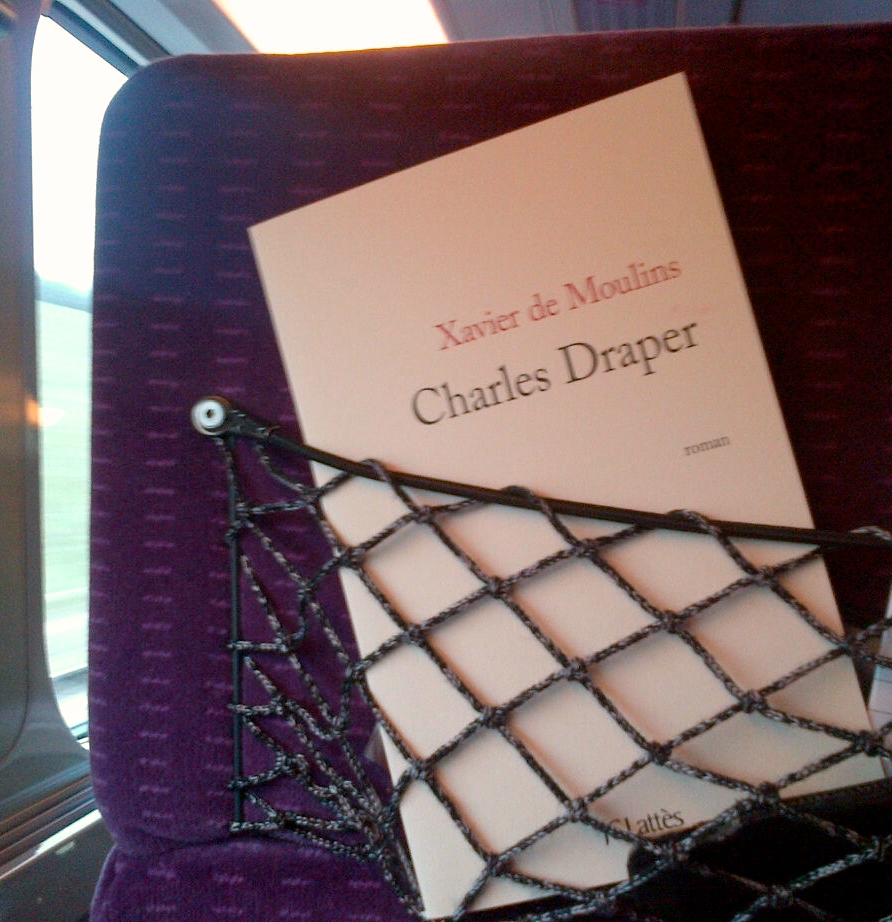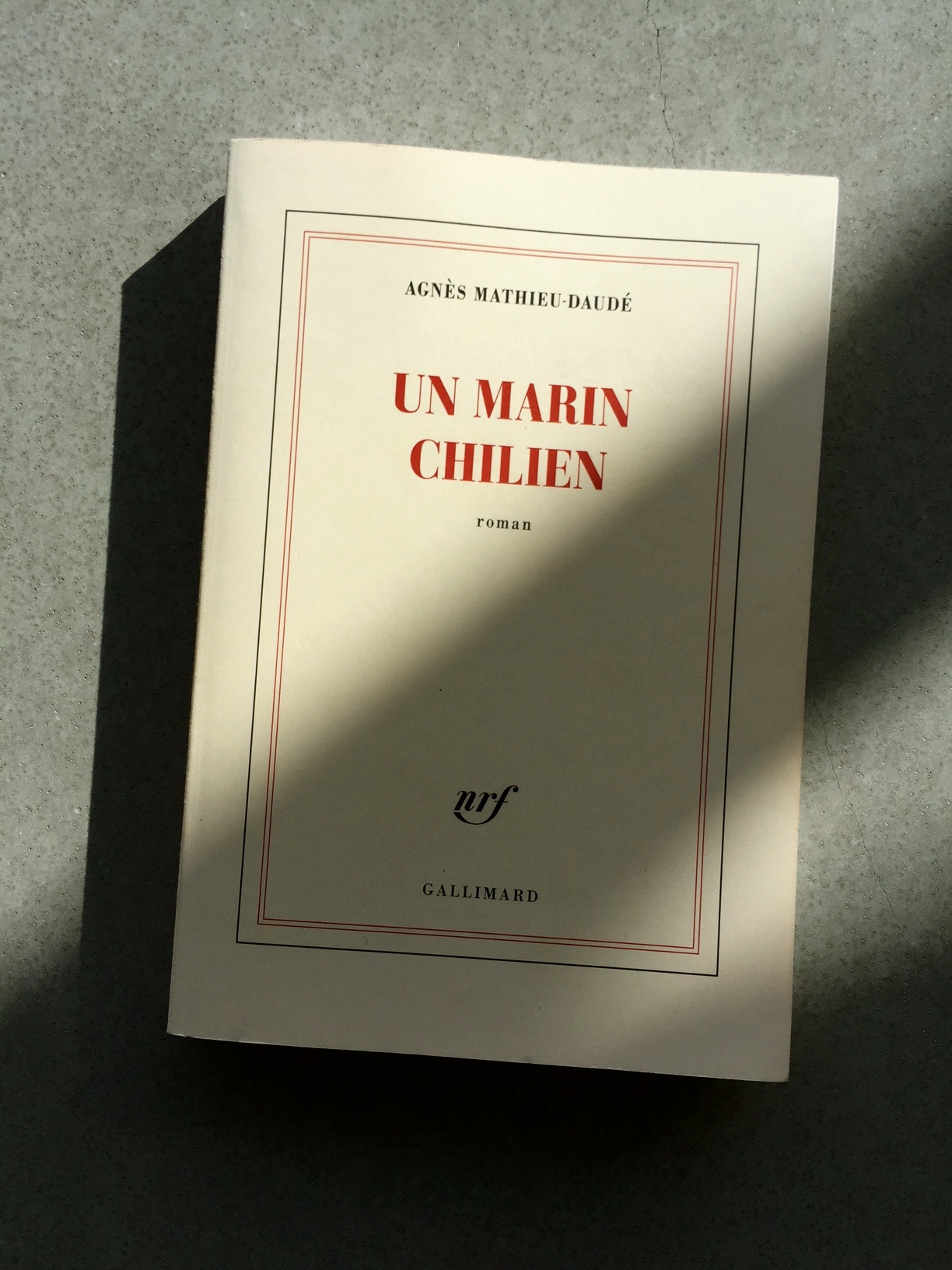Dans Les Tontons flingueurs, la guerre psychologique, c’était le bourre-pif. On frappait d’abord, on causait après.
Dans Le Soldat fantôme*, Jean-Guy Soumy nous fait découvrir le 23e régiment qui, en mars 1945, pratiquait lui aussi la guerre psychologique face aux Allemands. Composé de tout ce qui compose une équipe de tournage de cinéma, ce régiment avait pour mission de leurrer l’ennemi en lui faisant croire à d’importantes manœuvres des Alliés. Illusions d’optique, sons amplifiés, etc – des petits David Copperfield avant l’heure.
Et parmi eux, Steven.
À quelques centaines de kilomètres de cette guerre hollywoodienne, la vraie. Berlin. La débâcle. Les bombardements. Les lâchetés, soudain. Les mensonges qui se découvrent. Les vies brisées. Les gens qui fuient.
Et parmi eux, Hannah.
Alors bien sûr, comme dans les films (puisque Soumy est ici un grand scénariste) Steven et Hannah vont se rencontrer et s’aimer, et ce n’est pas la guerre qui va les séparer. Mais la paix.
C’est là, la très jolie idée du roman : à l’instant même où les choses deviennent possibles, elle deviennent également impossibles.
Cette irrésolution résonne longtemps encore, une fois le livre refermé – j’allais écrire, le film fini.
*Le Soldat fantôme, de Jean-Guy Soumy. Éditons Robert Laffont (avec un logo modernisé). En librairie depuis le 3 mars 2016.